

 |
Quartier Bévaux (Verdun) |  |
| Le quartier Bévaux, situé à Verdun, a
accueilli des troupes montant au front durant la bataille de Verdun. Ces bâtiments,
construits entre 1883 et 1886 sur un site dominant la vallée de la Meuse,
accueillent aujourd'hui un lycée professionnel, le lycée Alain Fournier. |
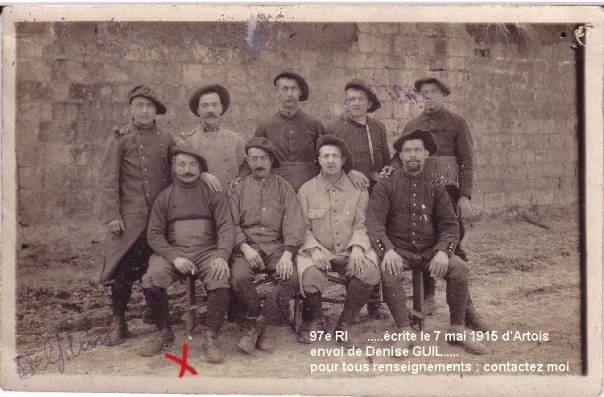
Affecté au régiment d’infanterie de Chambery.
Arrivé au corps le 17février 1915.
Passé au 97 Régiment d’Infanterie le 6 juin 1915.
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |
|
P17 : Le 6 (juin 1915), au sortir de la tente je trouve Maurice Martin qui revient de Chambery avec un convoi de 200 hommes. |
M Monbel : "enfin avant notre départ, la sacrée secousse du 28 janvier"
JMO du 97
28 janvier 1916
Le 28, à 16heures, attaque d’infanterie allemande sur le fortin et ses abords
Cf documents annexes ci joints :
-
compte rendu du chef de btn Serain, commandant le 2°bton de garde des
tranchées
-
compte rendu du chef de btn Bourgau, commandant le sous secteur le 28
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |
|
P82: (le 3 avril 1916) On déménage en vitesse les blessés de l’hopital StNicolas et ceux de l’ambulance 14/17 à la caserne où nous sommes |
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |
|
P108: Le 30 octobre (1016) On apprend que le 2° bataillon en entier, à l’exception de quelques rares rescapés est disparu prisonnier ou cerné à la Maisonnette dit-on. |
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |
|
P146: (le 5 juin 1917) Depuis 3 jours,
150 hommes du 97° sont partis. Du 3° bataillon principalement... |
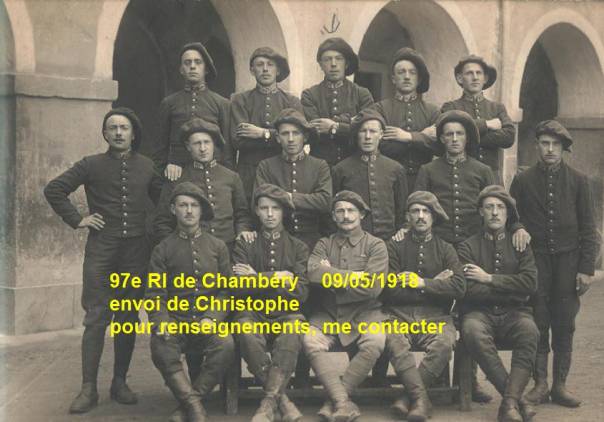
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |
|
P207: (le 17 septembre 1918) Entré dans Reims la nuit. La ville est envahie par le gaz |
|
(159 (Briançon) et 97 (Chambéry) forment la 88° Brigade) DI 77 Composition au cours de la guerre (Wikipedia)
1914Constituée le 5 septembre 1914, sous le nom de DI. Barbot, avec l’une des brigades de la 44e D.I. disloquée. 5 – 12 septembre
12 – 28 septembre
28 septembre – 1er octobre
1er octobre-14 novembre
14 novembre 1914 – 9 mai 1915
19159 – 27 mai 1915
27mai – 2 juin
2 juin 1915 – 24 février 1916
191624 février – 13 mars
13 mars – 3 avril
3 avril – 15 mai
(Des éléments de la DI. sont détachés, avec le 8e CA. dans le secteur Chauvoncourt, les Paroches.)
15 mai – 27 juillet
27 juillet – 19 août
19 août – 1er octobre
1er – 16 octobre
16 octobre – 4 novembre
4 – 29 novembre
29 novembre 1916 – 17 mars 1917 ·
191717 mars – 20 mai
20 mai – 3 juin
3 – 24 juin 1917
24 juin – 8 juillet
8 – 27 juillet
27 juillet – 3 septembre
3 septembre 1917 – 19 janvier 1918
191819 janvier – 6 mars
6 – 25 mars
25 mars – 1er mai
1er – 12 mai
12 mai – 22 juin
22 juin – 15 juillet
15 juillet – 3 août
3 – 24 août
24 août – 29 septembre
29 septembre – 12 octobre
12 octobre – 3 novembre
3 – 11 novembre
RattachementsAffectation organique: 33e Corps d’Armée, d’octobre 1914 à novembre 1918 Ire Armée 5 – 28 septembre 1914 11 – 29 avril 1916 15 mai – 13 août 1916 6 novembre 1916 – 21 mars 1917 IIe Armée 29 septembre – 12 novembre 1914 8 mars – 10 avril 1916 IIIe Armée 22 mars - 24 mai 1917 26 mars – 3 mai 1918 IVe Armée 6 – 24 mars 1918 Ve Armée 25 mars 1918 16 – 18 juillet 1918 20 juillet – 14 août 1918 23 août – 29 septembre 1918 VIe Armée 2 – 7 mars 1916 14 – 21 août 1916 8 septembre – 5 novembre 1916 25 mai – 26 juillet 1917 15 juillet 1918 15 – 22 août 1918 19 octobre – 11 novembre 1918 VIIe Armée 7 août 1917 – 19 février 1918 4 mai – 23 juin 1918 VIIIe Armée 20 février – 5 mars 1918 IXe Armée 8 – 14 juillet 1918 19 juillet 1918 Xe Armée 12 novembre 1914 – 1er mars 1916 22 août – 7 septembre 1916 24 juin – 7 juillet 1918 D.A.L. 30 avril – 14 mai 1916 G.A.F. 30 septembre – 18 octobre 1918 |
|
LE CORPS D' ARMÉE : En 1914 l'effectif d'un Corps d'Armée est d'environ: 40 000 hommes dont 30 000 combattants. Son transport, a effectif complet nécessite 120 trains. Le corps d'Armée qui est commandé par un général de Corps d'Armée comprend: deux divisions d'Infanterie, une cavalerie de Corps, une artillerie de Corps, des formations du Génie, des services et des parcs. Les principales composantes de cette unité sont: Le quartier général : on y trouve l'état-major ainsi que les chefs des différents services, soit 55 officiers et 280 hommes de troupe qui disposent de 3 voitures automobiles et de 30 voitures hippomobiles. L' état-major d'artillerie : avec à sa tête un général commandant l'artillerie du corps qui est chargé des aspects techniques et du ravitaillement des parcs d'artillerie. On y trouve également 4 officiers adjoints, un officier d'administration d'artillerie et des secrétaires cyclistes ainsi que des conducteurs. L'artillerie de Corps : Composée de 4 groupes, elle totalise un effectif de 70 officiers et plus de 2000 hommes et 2000 chevaux. L' état-major du Génie : il comprend 4 officiers. Les formations du génie de corps : Elles se composent de: 2 compagnies de sapeurs mineurs , 1 compagnie d'équipages de pont et 1 compagnie de parc du Génie. Le parc du génie dispose de 19 voitures et de 215 chevaux pour transporter 5000 sacs à terre, des outils de parc ainsi que des outils portatifs. L'intendance de Corps : 5 officiers et 17 hommes Les sous-intendances : une sous-intendance pour l'état-major ( 4 officiers et 10 hommes), une sous-intendance pour le convoi administratif et l'exploitation ( 3 officiers et 6 hommes) et une sous-intendance chargée du ravitaillement en viande fraîche ( 3 officiers et 6 secrétaires) Le convoi administratif : divisé en deux sections de qui comprennent chacune: 2 officiers et 35 hommes de l'administration, 5 officiers et 300 hommes du train des équipages avec 450 chevaux attelant 180 voitures. Le parc de bétail : administré par 7 officiers et 125 hommes qui disposent de deux sections de 8 voitures automobiles ( autobus réquisitionnés) pour transporter le viande au front. Le service de santé : le corps d'armée dispose de 4 ambulances, 3 sections d'hospitalisation et un groupe de brancardiers. Le groupe de brancardiers comprend: 3 médecins, 2 officiers d'administration, 2 officiers du train, 4 aumôniers, 6 médecins auxiliaires, 215 infirmiers et brancardiers et 83 conducteurs avec une centaine de chevaux, 27 voitures, 141 brancards et environ 5000 pansements. Le service vétérinaire : on y trouve, un vétérinaire principal et un vétérinaire adjoint. Le service de la trésorerie et des postes : sous la direction d'un payeur principal, il comprend: 5 officiers, 7 sous-officiers avec 13 chevaux et 6 voitures. La prévôté: la prévôté de corps comprend un capitaine commandant le quartier général, un chef d'escadron prévôt et un capitaine chargé des convois avec une cinquantaine de gendarmes. LA DIVISION D' INFANTERIE : En 1914 l'effectif d'une division d'infanterie est de 380 officiers et 15 500 hommes, elle dispose de 2 800 chevaux, 36 canons et 523 voitures. Sur route elle forme un convoi de 13,5 Km de long. La division qui est commandée par un général de division (trois étoiles) comprend: Un état-major : 1 officier supérieur, chef d'état-Major; 2 officiers d'état-Major; un capitaine du Génie; 4 officiers d'état-Major de complément, un interprète, un porte fanion, 25 secrétaires, estafettes ou ordonnances et 6 cavaliers d'escorte. Il est muni d'une automobile, d'une voiture-colombier, de deux fourgons à bagages. Deux brigades d'infanterie: 270 officiers et 13 000 hommes. Deux régiments d'infanterie forment une brigade commandée par un général (2 étoiles) assisté par deux officiers d'état-Major et 4 secrétaires. Un escadron divisionnaire: commandé par un capitaine, son effectif est de 5 officiers et 150 cavaliers. L'escadron est divisé en quatre pelotons commandés chacun par un lieutenant ou un sous-lieutenant. L'escadron comprend en plus des officiers: 1 maréchal des logis chef, 1 maréchal des logis fourrier, maréchal des logis adjoint à l'officier d'approvisionnement, 8 maréchaux des logis, 1 brigadier fourrier, 16 brigadiers, 1 brigadier maréchal ferrant et ses trois aides, 4 trompettes, 1 infirmier, 2 conducteurs, 96 cavaliers montés et 10 cavaliers non montés. L'artillerie divisionnaire: 54 officiers et 1600 hommes, soit 3 groupes de 75 (36 canons) et un état-major d'artillerie comprenant 3 officiers et les chefs des différents services. L'artillerie divisionnaire est commandée par un colonel assisté de 5 officiers adjoints. Une compagnie du génie: 1 capitaine, 3 lieutenants, un médecin auxiliaire, 17 sous-officiers, 17 caporaux, 1 cycliste, 210 sapeurs et 16 conducteurs dont 2 gradés. La compagnie possède : 21 chevaux, 2 fourgons à vivres, 1 cuisine roulante, 1 voiture à bagages, 3 voitures de sapeurs-mineurs et une voiture légère d'explosifs. Deux ambulances: chaque ambulance comprend: 6 médecins, un pharmacien, 2 officiers d'administration, 28 infirmiers, 13 conducteurs, 19 chevaux, 6 voitures, 20 brancards, et plus de 2 000 pansements. LE REGIMENT D' INFANTERIE : En août 1914, l'infanterie de l'armée d'active compte 173 régiments d'infanterie dont l'effectif réglementaire est de 113 officiers et 3226 hommes de troupes. Le régiment se compose de 3 ou 4 bataillons (1), d'un état-major, d'un petit état-major, d'une section hors rang, de deux sections de mitrailleuses et de12 éclaireurs montés. (1) 9 des 173 régiments d'infanterie sont à quatre bataillons, les autres à 3. Le bataillon est commandé par un chef de bataillon (commandant) assisté par un adjudant-major et un médecin. Le bataillon est divisé en quatre compagnies. La compagnie est commandée par un capitaine, elle est divisée en 4 sections. Son effectif comprend le capitaine, 3 lieutenants, un sous-lieutenant ou un adjudant-chef, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 sergent fourrier, 8 sergents, 1 caporal fourrier, 16 caporaux, 2 tambours, 2 clairons, 1 infirmier, 4 brancardiers, 1 tailleur, 1 cordonnier, 1 cycliste, 3 conducteur et 210 soldats. La section se décompose en 2 demi-sections ou 4 escouades (environ 65 fusils), elle est commandée par un lieutenant ( ou un sous-lieutenant, ou un adjudant ) L'escouade 15 soldats groupés sous le commandement d'un caporal forment une escouade. La section hors-rang comprend des artificiers, armuriers, secrétaires, ordonnances, sous-officiers d'approvisionnement, maréchaux-ferrants, bouchers et 21 conducteurs. LE BATAILLON DE CHASSEURS : L'origine des bataillons de Chasseurs remonte au Duc d'Orléans (fils aîné de Louis Philippe) qui fonde en 1837 une ''compagnie de Chasseurs d'essai'' dans le but de tester non seulement le nouveau fusil rayé, mais aussi l'efficacité d'une troupe très mobile et spécialement instruite au tir. L'année suivante, le 14 novembre 1838, l'expérience est étendue à un bataillon complet avec la création du ''bataillon provisoire de Chasseurs à pied''. Le 28 août 1839 ce bataillon change de nom et devient le ''bataillon de Tirailleurs'', un nom qu'il conservera jusqu'au 28 septembre 1840, date à laquelle, le Duc d'Orléans est chargé de la formation et de l'organisation des dix premiers ''bataillons de Chasseurs à pied''. En 1853, l'armée française compte 20 bataillons de Chasseurs, après la guerre de 1870 ils sont au nombre de 30. A partir de 1879 certains bataillons sont détachés dans les Alpes pour être entraînés à la guerre en montagne. Une expérience qui conduit quelque années plus tard à la création d'un corps spécial de montagne. Douze bataillons spécialisés prennent en janvier 1889 le nom de ''bataillons alpins de Chasseurs à pied'' qui deviendra par la suite '' bataillons de Chasseurs alpins''. Composition des bataillons de Chasseurs de l'armée d'active en 1914: Le Bataillon de Chasseurs à pied comprend six compagnies de 250 hommes, une section hors- rang et une section de mitrailleuses soit un effectif d'environ 30 officiers et 1700 hommes. A noter que l'effectif réglementaire des bataillons de chasseurs alpins était de 32 officiers et 1550 hommes. Le bataillon est commandé par un chef de bataillon (commandant) Chaque compagnie est commandée par un capitaine, elle est divisée en 4 sections. Son effectif comprend: le capitaine, 3 lieutenants, un sous-lieutenant ou un adjudant-chef, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 sergent fourrier, 8 sergents, 1 caporal fourrier, 16 caporaux, 2 tambours, 2 clairons, 1 infirmier, 4 brancardiers, 1 tailleur, 1 cordonnier, 1 cycliste, 3 conducteurs et 210 soldats. La section se décompose en 2 demi-sections ou 4 escouades (environ 65 fusils), elle est commandée par un lieutenant ( ou un sous-lieutenant, ou un adjudant ) La section de mitrailleuses se compose d'un officier, d'un sergent, de 4 caporaux, 24 soldats, 13 chevaux et une voiture. Dans les bataillons alpins les soldats sont au nombre de 28 et les chevaux sont replacés par 15 mulets de bât. L'escouade: 15 soldats groupés sous le commandement d'un caporal forment une escouade. La section hors-rang comprend des artificiers, armuriers, secrétaires, ordonnances, sous-officiers d'approvisionnement, maréchaux-ferrants, bouchers et conducteurs.
|
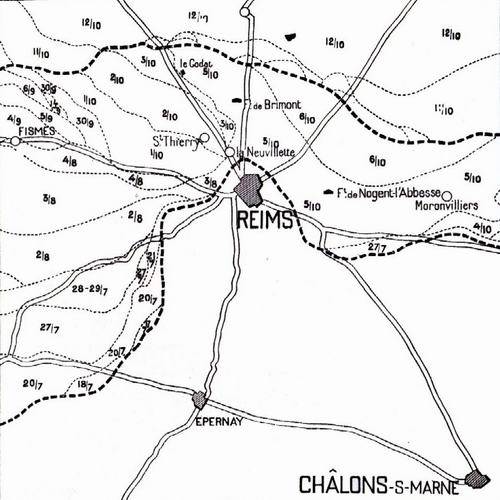

Conformément à l’ordre général n°41 transmis sous n°618/3 du 23 août 1918 – le 1° bion fait mouvement en camions autos de Mosxxx à Champfleury où il cantonne pendant la journée du 25 (embarquement à 0h1).
Dans la nuit du 25 au 26 ce bion relève un bion
du 100 RI dans le sous secteur nord de Reims
Le reste du Régiment (E.M.(etat major)-C.H.R. – 2° Bton et
3° Bton) fait mouvement par voie de terre dans la nuit du 25 au 26
et va cantonner savoir : E.M. C.H.R. et 3° Bton à
Villers-Allerand, le 2° Bion à Montchenot
Les 7 c. et 7 R. vont bivouaquer savoir :
7 c. carrefour &km S.O. de Chigny sur chemin Mont Joli de Ludes
Le 7R. 1500m E de Vourimont sur rouxx de ville en Sxxx
Tous ces mouvements sont exécutés en conformité des
ordres particuliers et notes de service indiquées ci-après :
1°/ % particulier n°76- de transmission n° 621/3 de la 77 DI en date du 23 août
1918
2° : % particulier n°77 de transmission
n°624/3 de la DI 77 en date du 24 août 1918
3° % particulier n°80 n°626/3 de transmission du 24 août 1918
4° % particulier n°79 n°627/3 de transmission du 24 août 1918
5° % particulier n°629/3 n°629/3 DJ 77 du 24 août 1918
6° % particulier n°86 n°545/3 de transmission du 24 aout1918
26 août
L’E.M. du Régiment, la CHR, le 2° et 3° Bton relèvent
pendant la nuit du 26 au 27 les unités encore en ligne du 100 RI dans le s°Secteur
Reims Nord
27 août
Avant les lever du jour les Allemands exécutent un coup de main sur la 1°
Cie (sentinelles aux boyaux de Reims et de Beauvais) et au cours de cette opération
un soldat est tué, sept sont blessés, un est disparu. Bombardements violents
dans les cours de la journée qui causent la mort de trois hommes du 2° Bton
29 Août
Un soldat blessé
Les capitaines Chatelain et Abel évacués rejoignent le régiment
1 Septembre
1 tué
1 blessé
2 Septembre
1 blessé
3 Septembre
Les trois Btons sont en ligne et occupent le s/secteur Nord
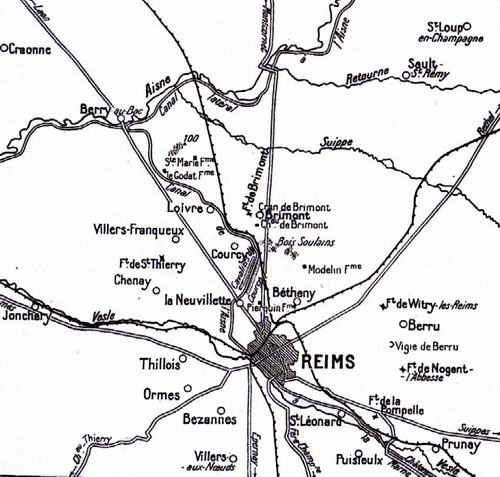
4 septembre
Les trois Btons sont en ligne sans changement
Septembre
L’ennemi a fait un coup de main dans la nuit du 3 et 4 sur le CR La Cuve (PA (parc
d’artillerie) C.B.R.). L’ennemi a été repoussé et a emmené 1 sergent
et 3 hommes (disparus)
5 septembre
Le régiment est en secteur – sans changement
6 septembre
Le régiment est en secteur – un coup de main a été tenté par le 3 Bton
(cr la Cuve) sur les tranchées allemandes SE de Betheny _ aucun résultat – 3
blessés légers
7 septembre
Sans changement
8 septembre
Sans changement – le régiment est en secteur en entier
9 septembre
Situation inchangée
9 septembre
Sans changement
10 septembre
Sans changement
12 septembre
Situation des Btons sans changement
Ils occupent les mêmes CR
Les allemands ont tenté un coup de main dans la nuit du 11 à 5h sur le PP de
l’ouvrage de Charvey
(CR NeufChatel) – pertes : 1 officier tué (SsLt Renaud 2°Cie)
3 blessés légers 3 soldats disparus
13 septembre
Le régiment est en ligne sans changement
14 septembre
Le régiment est en ligne sans changement.
Les allemands ont tenté un coup de main ce matin à 5 heures sur la ferme
Pierquin.

Bombardement du CR Neufchatel par gros minexxx (210)
Pertes : 1 sergent blessé
15 septembre
Sans changement. Le Régiment est en ligne
16 septembre
Le sous secteur nord du régiment est réduit à 2 CR (CR Neufchatel et CR
Arsenal). La CR LaCure passe au s/secteur Est xx n° 367/1 de l’xx D77 du 14
septembre 18
Le 3° Bton, en conséquence qui occupait le cr La Cure est relevé
par le II/159° est passe en reserve d’ xx à Blois. Pas de changement pour
les ° et 1° Bton
II Personnel
Néant
17 septembre
Sans changement 1° Bton occupe le CR Neufchatel 2°
Bton
occupe le CR Arsenal Le 3° Bton
est en reserve d’xxD à Blois (14 R des Moissons à Reims)
II Personnel
Néant
18 septembre
I Opérations
Situation inchangée, les 1° 2° sont en ligne 3° Réserve d’ID77
II Personnel
Néant
19 septembre
I Opérations
Sans changement
20 septembre
I Operations
Reçu o 869/3 du 19 septembre 18 de la 77° DI – Le régiment n’aura plus
que 2 Btons en ligne – le 3 bon sera dans un cantonnement de repos
un peu à l’arrière – En conséquence les 1er et 2e Btons
restent en ligne sans changement – le 3 Bton fera mouvement dans la
nuit du 20 au 21 pour aller cantonner provisoirement à Chigny les Roses
II Personnel
……….
21 septembre
Sans changement – 1er & 2° Btons en ligne – 3°
Bton au PC Blois en réserve d’ID
22 septembre
Sans changement
 23
23
Reçu xx 421/1 de l’ID77 du 21 sept 18 par lequel
le 2° bton du 97
au CR Arsenal est relevé par le 60° B.C.P. – Le 2° Bton
va en réserve d’ID au PC Blois – Le 1er Bton reste en
ligne CR Neufchatel
II Personnel
Neant
24 septembre
I Opérations
Recu xx 936/3 du 23 sept 18 de la 77° DI par lequel le 1° Bton est
relevé dans la nuit du 24 au 25 dans le CR Neufchatel par le 56° B.C.P. Apres
relevé le 1er bton va cantonner à Rilly-la-Montagne
II Personnel
Neant
25 septembre
I Opérations
Par la note 936/3 du 23 xxx 18 de la 77° DI – Le régiment doit faire étape
vers la Région d’Avenay ou il stationnera pendant une période de 10 jours
qui sera réservée à l’instruction – relève du 1/97° par 56° BCP à
Neufchatel. Le Lt Cl Cdt le 97° conserve le commandement du xxx Reims
xxxx jusqu’au 26 – 13 heures
II Personnel
…..
Etat numérique et nominatif des pertes éprouvées par
le régiment
Pendant les affaires du 25 août au 25 septembre 1918
|
|
Tués |
Blessés |
Disparus |
Total |
|
Officiers |
1 |
5 |
|
6 |
|
Troupe |
16 |
131 |
8 |
155 |
|
Totaux |
17 |
136 |
8 |
161 |
Blesses : 7°Cie Monbel Joseph
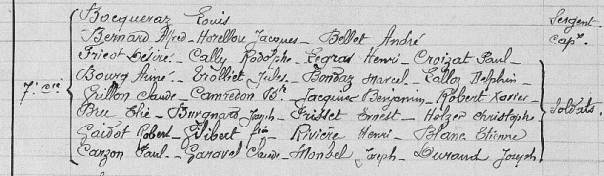
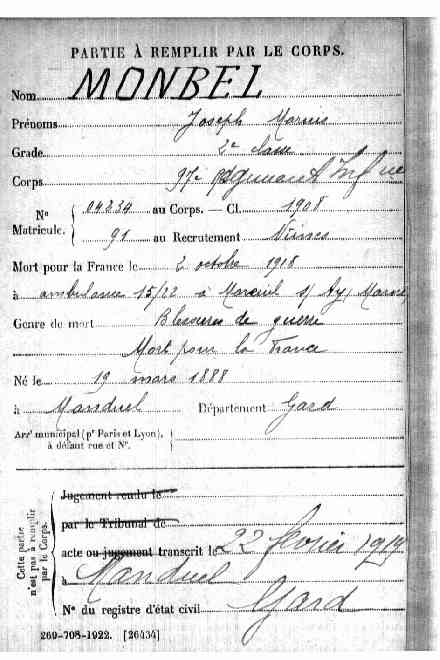
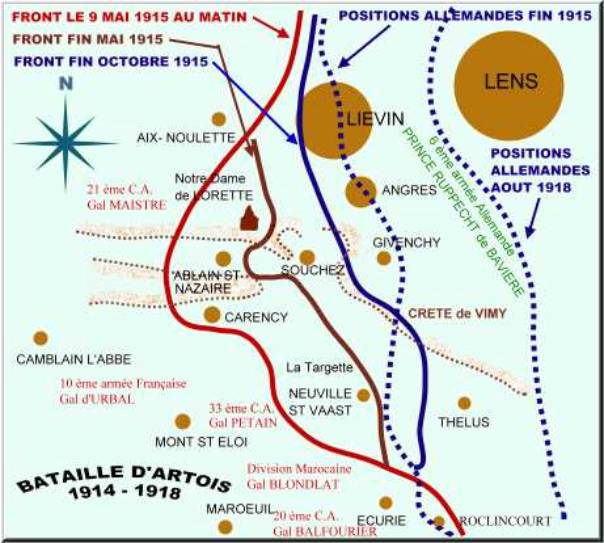
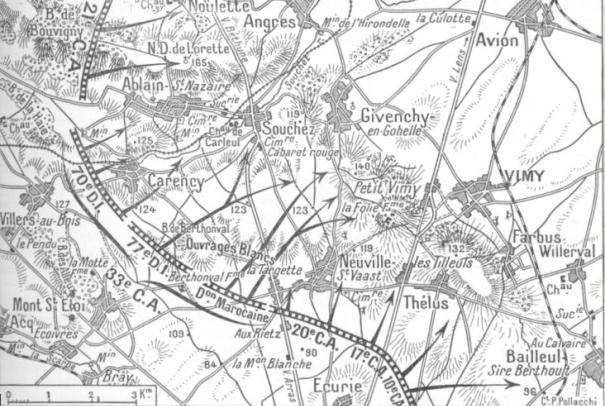
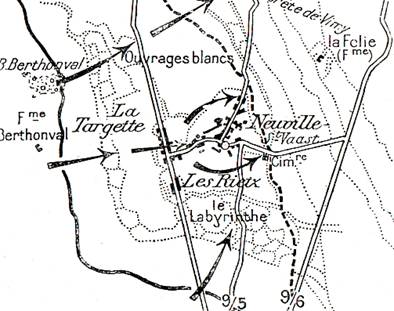
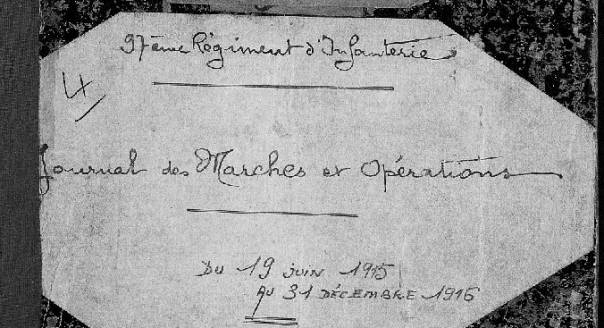
19 juin 1915 (Frevillers)
Le régiment est relevé le 18 au soir sur ses emplacements par le 282° RI
(sauf le 4 bion qui, réserve de division, reste sur le terrain) et vient
occuper le cantonnement de Frevillers (v. dossiers opérations 18 juin, exécuter
de l’ordre du lt. colonel de Comxxx, de 9h30).
Le 19 à 10 heures la situation du régiment est la suivante :
A Frevillers, au cantonnement : 1, 2, 3 Btons ci Mitxx CHR E.M.
du régiment.
En réserve de division, au point G le 4° Bton.
(TR à Villers-Brulin TC à Frevillers).
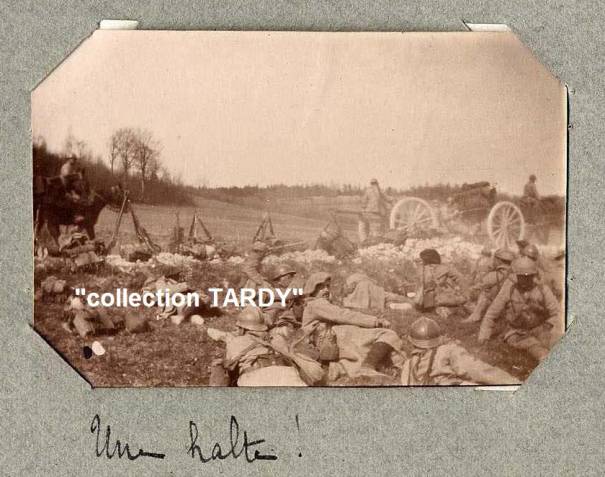
http://chtimiste.com/album%20photos/perso/tardy/tardy1/tardy1.htm
20 juin 1915 (Frevillers)
Commencement de réorganisation du régiment au point de vue encadrement,
conformément aux prescriptions de la note de la 77 division n° du 20 juin (7h)
(v. dossier opératoires).
Reçu du bataillon – dépôt de la 77° division 376 hommes de renfort (exécution
des prescriptions de la note n° de la 77° division en date du 19 juin).
22 juin 1915 (Frevillers)
Alerte de régiment conformément à % 77 division du 22 juin à 9h30 (v.d.o.)
ordre reçu à 10h ; régiment prêt à partir à 11 heures.
Réorganisation des unités au pdv encadrement (cf. supplément à la décision
du 22 juin portant nominations et citations à l’% du régiment.
23 juin 1915 (Frevillers)
à 2h30 départ des chefs de Bton pour la reconnaissance de
secteur prévue au #1 note 77° division du 22 juin 10h45 (cf. d.o.).
cf. d.o. ordre du colonel de Combarieu fixant les détails de la relève prévue
dans la note précédente (ordre de relève n°3).
Note n°2 du colonel de Combarieu fixant l’organisation du service de santé
dans le secteur du 23 au 27 juin.
Le relève s’effectue dans la nuit du 23 au 24 conformément à l’% ci
dessus.
24 juin 1915 (secteur de Souchez)
installation du régiment dans le secteur de Souchez. Dans le s/secteur de
droite, tentative de progression de la 14°Cie (s/lieutenant Pischi)
dans DD’ (voir croquis D.O.), se bornant à une lutte à coups de grenades.
Durant la journée, bombardement peu intense, mais ininterrompu du secteur par
artillerie lourde ennemie.
25 juin 1915 (secteur de Souchez)
nuit du 24 au 25 et journée du 25 assez calme, bombardement ininterrompu,
mais peu intense de 13 à 16 heures sans dégât = aucune attaque
d’infanterie.
26 juin 1915 (secteur de Souchez)
Bombardement ininterrompu du secteur par la grosse artillerie de 7 à 12h30
–organisation du secteur.
27 juin 1915 (secteur de Souchez)
Journée calme ; léger bombardement de 12h30à 16h
cf. ordre de relève (n°4) pour mouvement à effectuer durant relève du 27 au
28 = relève exécutée conformément à cet ordre.
Pertes du 24 au 28 juin
Mr le Lieutenant Thermz tué
Mr le s/lieutenant Monteil blessé
Troupe {tués 53, blessés 134, disparus 2} 189
28 juin 1915 (Magnicourt)
Installation au cantonnement, à Magnicourt, du 97° descendant du secteur
de Souchez.
Organisation d’un cours d’instruction pour grenadiers (v. décision du
jour).
29 juin 1915 (Magnicourt)
Révision des effectifs, de l’encadrement des unités.
30 juin 1915 (Magnicourt)
Exercice autour du cantonnement dans chaque Cie
Revue des chef de section par le chef de corps.
1 juillet 1915 (Magnicourt)
Exercice autour du cantonnement dans chaque Cie ; revues
Instruction spéciale du groupe des grenadiers régimentaires.
2 juillet 1915 (Magnicourt)
comme le jour précédent
3 juillet 1915 (Magnicourt)
Matinée à la disposition de chaque bion (marches- exercices).
Soirée : revues – organisation de séances récréatives.
4 juillet 1915 (Magnicourt)
Matinée à la disposition des Btons (exercice de courte durée
aux abords du cantonnement).
Soirée : séances récréatives, - concert.
5 juillet 1915 (Magnicourt)
Matinée : préparatifs de départ pour la relève (cf. d.o. ordre de
relève n°5, du 5 juillet, à 8h)
2. soirée – exécution de la relève conformément à l’ordre ci –dessus.
5-9 juillet 1915 (Magnicourt)
Aucune action offensive.- Travail d’organisation du secteur dans toute la
partie (ouvrages, tranchées, voies de communication) sont soumises de jour et
de nuit à un bombardement d’artillerie lourde violent et continu, sans cesse
bouleversées et détruites.
Pertes du 9 au 15 juillet
Troupe {tués : 56 blessés : 88, disparus : 5} 149
Du 5 au 9 dans le secteur de Souchez
10 juillet 1915 ( Magnicourt)
Retour au cantonnement de Magnicourt du régiment relevé du secteur de
Souchez : mouvement terminé le 10 à 9 heures.
Installation.
11 juillet 1915 ( Magnicourt)
Exercices aux abords du cantonnement – Jeux.
12 juillet 1915 ( Magnicourt)
Exercice au cantonnement.
Reçu à 19 heures ordres n°410/3 et 411/3 de la 77° division en date du 12/7.
Cf. ordre en conséquence (n°7) donné par le chef de corps aux 1° et 4° Btons
et à la Cie mit2.
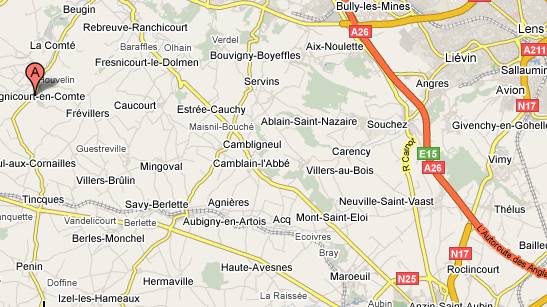
13 juillet 1915 ( Magnicourt)
Reçu à 4h confirmation ordre à ordres 410/3 et 411/3 de la veille. Voir
d.O. note de la 88°brigade n°312A.
-Reçu à 9h30 ordre 77 division n° 450/3 de la 77°division en date du 13/7 à
8 heures.- En exécution, le chef de corps désigne les 9° et 11° Cies
pour assurer la relève prévue au #IV de l’ordre ci-dessus
-Reçu 18h30 télégramme confirmé par ordre 416/3 de la 77° division en date
du 13 juillet (v.d.o.). = exécution immédiate des prescriptions de cet ordre :
le 1° et 2° Btons se rendent avec le chef de corps à Caucourt.
_ 2Cie du 4 Bton à Villers au Bois, 2° Cie à
Cambligneul._ La C.H.R. et 2 Cies du 3 bion, rentrant du secteur de Souchez (10°
et 12°) restent à Magnicourt.
14 juillet 1915 ( Caucourt)
-Situation du régiment le 14 au matin :
a/ à Caucourt : E.M. _ 2 Btons (&° et 2°) en réserve
de C.A.
b/ au secteur de Souchez : 4Cies en réserve de division à
Carency.
(2 Cies du 3° Bton _ 2 Cies du 4°Bton)
c/ à Cambligneul : 2 Cies du 4°Bton
d/ à Magnicourt : C.H.R. et 2 Cie du 3° Bton
_TC avec leurs unités _ TR à Villers Brûlin
_Reçu à 12h30 compte rendu du commandement Brébion co.mmandant les 4 Cies
réserve de secteur à Carency (v.d.O.)
_ 2 Cies cantonnées en réserve de division à Cambligneul (14 et
15) reçoivent directement l’ordre du Général de Division de se porter, en
cours d’après midi, au secteur de Souchez.
A 17 heures, le 97 a 6 compagnies dans le secteur (4° Bton, 9° et
11°).
15 juillet 1915 ( Caucourt)
Les 6cies en réserve de division à Carency rejoignent le cantonnement de
Cambligneul (exécution de l’ordre 452/9 de la 77°division en date du 15
juillet 1915 _ voir d.O.).
16 juillet 1915 ( Caucourt)
Dans chaque cantonnement, exercice par Cie
Pertes du 17 au 21 juillet
Ss lieutenant Rizet : blessé
Troupe {tués 14, blessés 58, disparus 3}
17 juillet 1915 ( Cancourt)
-Fait envoi à 9 heures à toutes les unités du corps de l’ordre de relève
à exécuter dans le secteur de Souchez dans la nuit du 17 au 18)
Relève, dans la nuit du 17 au 18, des troupes de garde du secteur.
18-21 Juillet Secteur 77° division.
Garde et organisation du secteur conformément aux ordres et instructions de la
77°division (voir d.O.), sans aucune action d’infanterie. – De part et
d’autre, le bombardement est la seule manifestation d’activité.
Au cantonnement (Magnicourt), instruction des élèves Chefs de section.-
adjonction au cantonnement de celui d’Heslin le vert, affecté à la Cie
de mitrailleurs.
22 juillet 1915 ( Magnicourt)
-Retour au cantonnement de Magnicourt de tout le régiment, Installation.
23 juillet 1915 (Magnicourt)
Emploi du temps conforme au tableau de service établi à la date du 22
juillet.
24 juillet 1915 ( Magnicourt)
Emploi du temps conforme au tableau de service (matinée).
L’après midi, inspection des cantonnements par le Général de la 77°DI.
25 juillet 1915 (Magnicourt)
cf. ordres de relève n°479/3 de la 77° DI en date du 23/7 et n°536 du
gr. Chasseur à pied du 24 juillet (d.O.).
Le mouvement prévu par les ordres ci-dessus est exécuté pour les 1° et 2° Btons,
2° Cie du 4 bion et 3 sections mitr. – Cf. à la suite de
l’ordre 536 les ordres de détails donnés par le chef de corps.
26 juillet 1915 (Magnicourt)
Tableau de service.
27 juillet 1915 (Magnicourt)
Tableau de service .
Pertes du 26 juillet au 6 Aout 1915
Récapitulation {tués 5, blessés 25, disparus -}
28 juillet 1915 (Magnicourt)
Tableau de service au cantonnement.
Inspection du TR par le chef de corps.
29 juillet 1915 (Magnicourt)
Tableau de service au cantonnement ; au cours de la matinée,
inspections des Cies par le colonel de la 88° brigade.
Installation au cantonnement des 1°, 2° Btons, 15° et 16 Cies,
3 sections de mitr., au retour du service de garde du secteur (24-28 juillet).
30 juillet 1915 (Magnicourt)
Tableau de service au cantonnement.
31 juillet 1915 (Magnicourt)
Tableau de service au cantonnement.
1 Août 1915 (Magnicourt)
Tableau de service au cantonnement
Reçu 7h ordre de relève 88° brigade n°541 en date du 31/7 (v.d.O.) – cf.
à la suite de cet ordre mesures de détail prises par le chef de corps.
Exécution, sans aucun incident, du mouvement aux heures et de la manière
prescrite par l’ordre ci-dessus.
1-5 août (secteur 77°division)
Garde et organisation du secteur, sans action.
Tableau de service pour les unités restées à Magnicourt.
6 Août 1915 (Magnicourt)
Installation au cantonnement, dans la matinée, des unités relevées la
nuit précédente.
8 Août 1915 (Magnicourt)
Tableau de service.
9 Août 1915 (Magnicourt)
Cf. d.O. ordre de relève 88° brigade en date.
Perte du 10 au 22 août inclus
Récapitulation {tués 2 ; blessés 18 ; disparus -}
Du 8 août, mesures de détails prises par le chef de corps
(même date) ordres complémentaires de la 88°brigade 9/8 à 9heures et 77°
division n°538/3 du 8 août.
Exécution du mouvement conformément aux ordres ci-dessus.
En première ligne : 1° et 2° Btons 97 + 3 sections.
A la Parallele Magne : 12°Cie
A Villers au Bois, Cie de travail : 14°Cie
10 août 1915
Magnicourt
1° 2° Btons 12° et 14° de service au secteur de 77 division.
Tableau de service pour les unités restant au cantonnement.
11 août 1915
Magnicourt
Comme le jour précédent.
12 août 1915
Magnicourt
Comme le jour précédent.
13 août 1915
Magnicourt
Neant (tableau de service habituel).
14 août 1915
Magnicourt
Retour au cantonnement, au cours de la matinée, des unités de garde dans le
secteur de la 77° division ( cf. 10 août 1914).
Tableau de service.
15 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
Prise d’armes des 11° et 12° Cies en exécution des prescriptions
de l’ordre général n°83 de la 77° DI en date du 13-8-15 (cf. d o).
16 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
Inspection du 2°Bton par le colonel de la 88° brigade à 7h30.
17 août 1915
Magnicourt
cf. d.O. mouvement de relève prescrit par % 88° brigade en date du 16 août,
et mesures de détails ordonnées par le chef de corps.
Au cantonnement, dans la matinée du 17, inspection par le général de 77° DI
des 1° 2° 5° 6° Cies (cf d.O. note 587 de la 88° brigade en date
du 15/8).
18 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
19 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
Exercice de cadres sous la direction du colonel et 88° brigade (cf. d.O. Ordre
n°594 de 88° brigade en date du 17 août 1915.
20 août 1915
Magnicourt.
Tableau de service.
21 août 1915
Magnicourt
Ordre de relève (cf. d.O. ordre du Lt colonel 159° en date du 20 août 1915) :
mouvement exécuté par le 1°Bton sous le Ct du capitaine Bodart.
Pour les unités restant au cantonnement, tableau de service habituel.
22 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
Retour au cantonnement, au cours de la matinée, des 3°, 4° Btons,
3 sections de mitrailleuses, relevés dans le secteur de la 77° division.
23 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
24 août 1915
Magnicourt
Tableau de service.
Prise d’armes en exécution de l’ordre général n°88 du 23 août 1915 ,
de la 77° division (2 Cies du 4° Bton).
25 août 1915
Magnicourt
Cf. d.O. ordre de relève du colonel Ct gr. Chasseurs en date du 24 août.
Le 2° Bton 97 (ct. Serein) prend la garde, en exécution de cet
ordre, dans le s/s du Cabaret Rouge.
Pour les autres unités, tableau de service.
26 août 1915
Magnicourt
Tableau de service habituel.
27 août 1915
Magnicourt
Tableau de service habituel.
28 août 1915
Magnicourt
Cf.d.O. ordre de relève (88°brigade, n°659, du 28 août 1915).
Bton du 97 : 3°Bton
Tableau de service habituel.
Organisations d’un cross couru par les officiers, sous la présidence du Cl Cd
la 88° brigade.
29 août 1915
Magnicourt
Exécution de l’ordre de relève pré-cité.
Exécution de l’ordre 638 de la 88°B. du 28 août (cf.d.O.) = 4°Bton
30 août 1915 – 12 septembre 1915
Magnicourt
Dans le secteur de la 77° DI, relèves effectuées normalement conformément au
tour de garde établi.
Tableau de service habituel au cantonnement.
13 septembre 1915
Magnicourt
Exercice de cadres conformément à l’ordre n°666 de la 88°brigade en date
du 8-9-15 (v.d.O.)
14 septembre 1915
Magnicourt
Exécution de l’ordre de relève n°674 de l a88br. En date du 13/9 unités de
relève : 3°Bton + 2Cies du 4°Bton
Au cantonnement : tableau de service – Inspection par le chef de
corps de TC du 4°Bton
15 septembre 1915
Magnicourt
Retour au corps, pares guérison de blessure, du capitaine Cyvoct (A), affecté
à la 9 Cie
16 septembre 1915
Magnicourt
Tableau de service habituel.
16-22 septembre 1915
Magnicourt
Préparation d’une attaque devant le front de la 77° DI (cf. d.O.)
Tableau de service habituel.
22-24 septembre 1915
Magnicourt
Continuation des préparatifs en vue d’une attaque sur le front de la 77° DI
Le 24 à partir de 13 heures, exécution de l’ordre de mouvement (cf. d.O.) se
rendant sur leurs emplacements de combat.
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Régiment d’infanterie Alpine) |
|
P39 : Le 25 (septembre 1915) canonnade violente tout le jour, le 97° a attaqué. Depuis 10h les blessés passent en grand nombre… La 9° compagnie et surtout la 13° celle de Michel, ont été amochés sérieusement. La plupart des blessés passent sur des wagons découverts qui sont remorqués par des chevaux de la gare de Carency à Villers au Bois. Beaucoup sont très gravement atteints. Pluie toute la journée, toute la nuit. Le 26 toujours des blessés après la soupe… Le 27 encore et toujours des blessés. Violente canonnade tout le jour. Assiste au dessus du creux de Carency au bombardement des côtes 169 et 140… Le 28 passage de blessés, la canonnade reprend vers 10h et dure toute la journée… Le 29 septembre toujours le canon. Il semble qu’on a avancé… P40 : Sibué du 2° bataillon va au point G chercher le corps du lieutenant Peuget et le Colonel De Maistre pour les porter à Frevillers où le dépôt du régiment a été transporté Le 30 au soir de nombreux fusants éclater sur la ligne. |
Perte du 7 au 18 septembre
inclus
Tués : 5 blessés :16, disparus : - 1h30, le 3° Bton
occupe les emplacements de combats
Soit :
Perte du 19 au 22 septembre inclus
Tués : 9 blessés :15, disparus : -
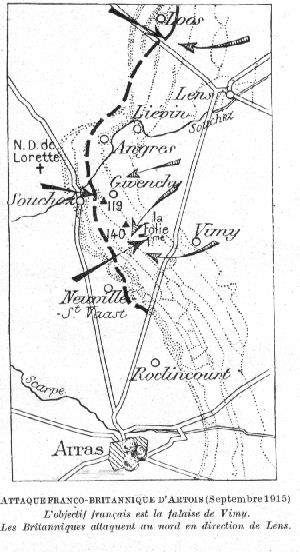
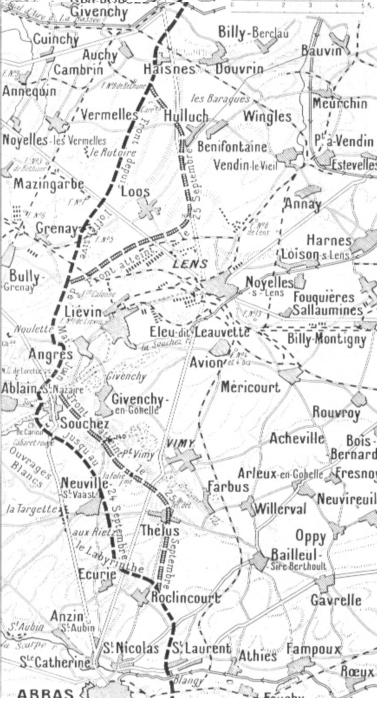
1°) Ordre d’attaque initial en exécution des
prescriptions de la note 1 du dossier secret de la 88° brigade du 9 septembre
1915, le chef de corps donne l’ordre d’attaque suivant :
L’attaque sera menée
en 1° ligne par les 3° et 4° Btons, et 1 Cie du 2° Bton
en 2° ligne par 3 Cies du 2° Bton
Elle sera appuyée par 6 sections de mitrailleuses (et 1cie de
mitrailleuses chasseurs installée moitié dans le boyau Campet, entre la route
de Béthune et le nouveau boyau Campet, moitié dans la P. Savourey à hauteur
de B3).
Le 3° Bton (Comdt Brebion) appuyant la droite successivement à
la route de Béthune, au boyau des Uhlans, au boyau amorcé (ces boyaux exclus)
aura à enlever C’- le cimetière – B’’’-C’’-C’’’- tranchée
de Cologne – du Landstury- chemin n°6, pour aller l’établir sur la cote
119 marquée par la tranchée de Lubeck et le carrefour 119.
Il aura à se couvrir face au N. par l’occupation des carrefours O et O’ où
il se reliera au 159° par l’occupation du boyau Cobourg.
Le 4°Bton (Comdt Dunoyer) avec 1°Cie du 2°Bton appuyant la gauche à la ligne précitée, sa droite à l’Ersatz (exclus) aura à enlever successivement D-D’-C’’-D’’-Cologne-Laudsturn-Chemin n°6 pour aller s’établir sur la cote 119. Il devra se relier étroitement à la 55° DI sur la ligne ersatz – lisière N du Bois des Ecouloirs. Bifurcation des tranchées de Lubeck et des Walkyries.
3 Cies du 2°Bton à la disposition du chef de corps.
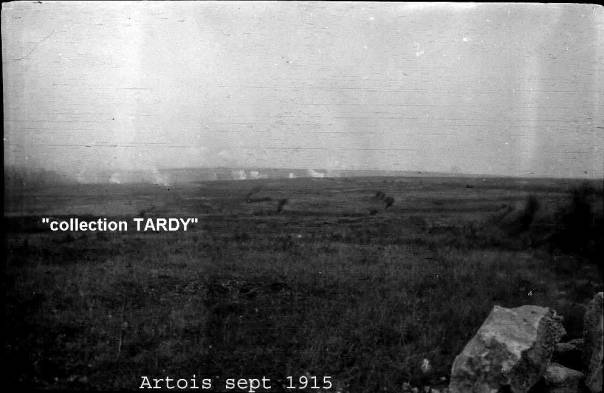
Les Btons d’attaque auront autant que possible en première
ligne :
Celui de gauche : 1 Cie
Celui de droite : 5 sections
Les autres Cies placées an arrière, destinées à faire 2 vagues
d’attaque successives.
Donc:
Bton de gauche (3°) : 1Cie en 1°ligne, la droite à
la route de Béthune incluse.
Bton de droite (‘°) + 1 Cie 2°Bton = 5
sections en 1°ligne, la gauche à la route de Béthune écluse, la droite à la
S.3 (55°DI)
Les Cies de renfort, destinées aux vagues d’attaque successives
seront réunies :
Btons de gauche :
1 Cie dans C
1 Cie P Savourel
1 Cie P Bigourdat ou à defaut B3-B1
Bton de droite :
5 sections P Savourey, trabchée XY
« B. Campet, P Savourey
Abris W3, B Campet
Les Cies de renfort de chaque Bton
se tenant prête à remplacer les Cies de première ligne dans
la tranchée de tir.
P Varoquier entre le B. du Cabaret Rouge et la route de Béthune, chaque Cie ayant 1 section engagée dans les B. Cabaret Rouge, B1-, B3
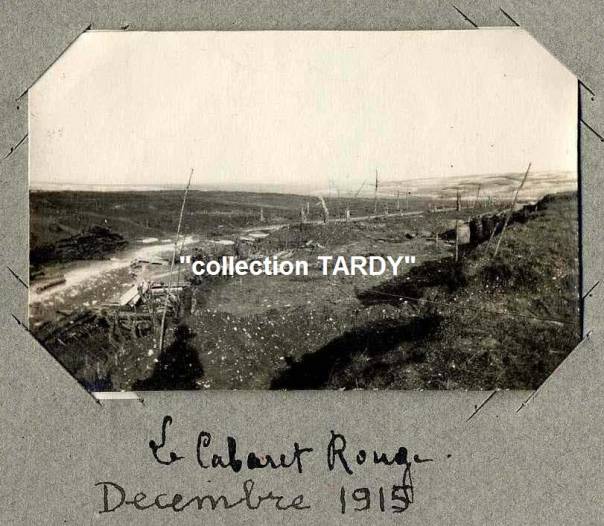
Se tiendront prêtes, au moment
de l’assaut, à prendre sous leur feu toute contre attaque ennemie. 3 sections
(1 au centre, 1 à chaque aile de la ligne) partiront avec les 3emes vagues et
se porteront sur les tranchées conquises pour aider les troupes d’attaque et
les soutenir en cas de besoin.
Les 3 autres sections resteront dans les tranchées de départ jusqu’à nouvel
ordre pour parer à toute attaque ennemie.
PC du colonel Cdt le 97° :
Abri W3
PC chef de Bton de droite : sape 5
«
de gauche : abri des mitrailleuses B du 57°
«
2°ligne : 1 abri de la route de Béthune
Les PC des chefs de Bton de 1°ligne seront reliés téléphoniquement
avec celui du Colonel _ poste Optique.
Cf. dossier brigade précité.
Les Cies de 1°ligne
partiront toutes ensemble à l’heure fixée et au signal donné par les chefs
de Bton. Elles ne s’arrêteront pas aux 1eres tranchées, mais
pousseront résolument sur les objectifs indiqués. Les Cies de
renfort déboucheront à petite distance les unes des autres (de 50 à 100m) et
retrouveront progressivement les éléments avancés. Il appartient aux chefs de
Bton de 1°ligne de fixer le moment où partira la dernière Cie.
Les 3 Cies du Bton de 2°ligne viendront après le départ
du dernier élément du Bton de 1°ligne xxxxx la tranchée de tir.
Les grenadiers de chaque Cie , aidés par quelques hommes choisis,
devront seuls occuper les tranchées conquises et en assurer le nettoyage. Les Cies
répartiront sur leur front les cisailles, pétards, appareils Filloux.
Les hommes chercheront à s’aligner et progresseront aussi loin que possible
sans s’arrêter dans la 1°tranchée conquise. Les chefs des unités de tête
recevront d’avance leur point de direction.
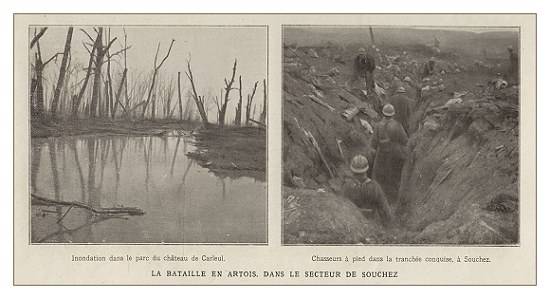
Dès que l’objectif sera
atteint ou quand on aura du s’arrêter, on plantera des fanions rouges, fera
des signaux adaptés pour demander l’artillerie. Si l’offensive vient à être
momentanément enrayée, on s’accrochera au terrain et on se retranchera.
Le boyau destinée à relier la tranchée de départ à la position conquise (D
prolongée) sera commencé dés le départ de l’attaque, il sera fait par les
pionniers du Régiment. La section du génie mise à la disposition du corps
gagnera rapidement les premières tranchées conquises pour les parcourir et éventer
les dispositifs de mines.
Magnicourt le 24 septembre 1915
Signé : de Combarieu
En exécution des ordres ci
dessus, le 25 septembre à 1h30, le
3° Bton occupe ses emplacements de combats soit :
11° Cie = tranchée de tir C.
9° Cie = tranchée conjuguée
10° Cie : P. Varoquier
12° Cie : P. Varoquier
A 12h25 (heure fixée pour l’assaut général) la 11° Cie sort de C pour se porter à l’attaque de la cote 119, tandis que la 9° Cie vient prendre l’emplacement laissé libre par la 11° Cie. Malgré un tir d barrage de l’artillerie ennemie très violent, les 9° et 11° Cies, après avoir subi des pertes sérieuses, arrivent à prendre pied dans la tranchée C’, suivies d’une partie seulement de la 10°c qui n’a pu toute entière venir occuper la tranchée de départ, du fait du bombardement violent des boyaux B1 et B3. Jusqu’à la nuit la tranchée C’ reste occupée et énergiquement défendue par un effectif de plus en plus réduit, composé d’éléments des 11°, 10° et 9° Cies. Quand à la 12° Cie, elle ne peut que profiter d’un moment d’accalmie dans le tir de barrage pour venir occuper la tranchée de départ C et servir de soutien à la garnison très précaire de C’. Lorsque à 21 heures le 1° Bton du 97° (jusque là en réserve de Division et de Brigade) vient relever le 3° Bton, cette garnison reçoit l’ordre de se replier.
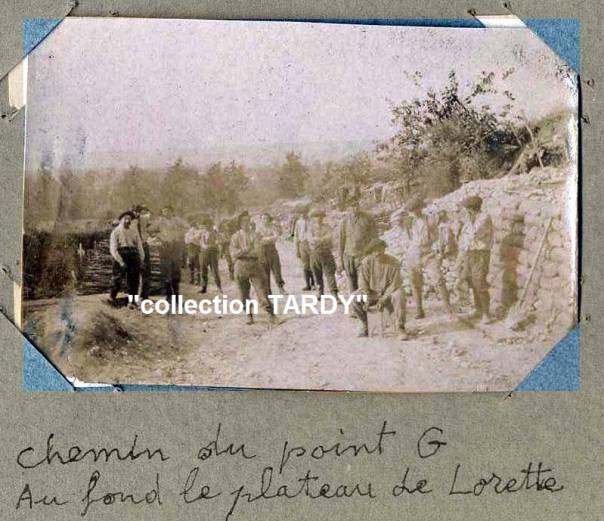
Relevé, le 3° Bton reste dans les abris W2 du boyau du cabaret rouge le 26 septembre de 1h à 5heures, puis va occuper la P. de Carency où les hommes peuvent se reposer durant la journée. A 17 heures le 3° Bton reçoit l’ordre d’aller occuper les abris P B4 en arrière du point G comme réserve de division, le mouvement est terminé à 21h30. Le 27, à 13h30, le chef du 3° Bton reçoit l’ordre de porter ses unités dans la P. Stirny ; le mouvement à peine terminé (16 heures), il recoit l’ordre de les reporter sur l’emplacement précédent ; ce nouveau mouvement est terminé à 21 heures ; le 3° Bton passe sur cet emplacement la nuit du 27 et une partie de la journée du 28. Le 28, à 16h30, le chef de Bton reçoit l’ordre de porter son Bton à la disposition du Général de Don dans les parallèles Varoqiuer et Savourey ; le mouvement est terminé à 21 heures. Le 30, à 16heures, le chef du 3° Bton reçoit l’ordre d’aller occuper avec ses unités les abris W2 du boyau du Cabaret Rouge et la P.Varoquier. Apres exécution de ce mouvement (17h30), le 3° Bton reste su ses emplacements jusqu’au 1° octobre à 18 heures, heure à laquelle, sur ordre, il quitte le terrain et gagne le cantonnement de Frevillers où il arrive le 2 octobre à 1h30.
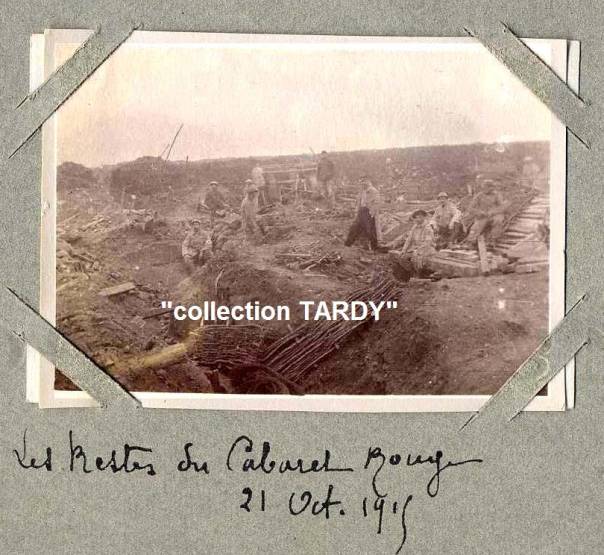
L’attaque du 4° Bton se déclencha, comme celle du 3° et en exécution des mêmes prescriptions le 25 septembre à 12h25. Dès le départ de la 1° vague, l’ennemi établit un tir de barrage d’artillerie lourde sur les sapes d’accès et la tranchée de 1°ligne sans toutefois gêner outre mesure le placement, puis le départ des unités successives. En même temps qu’il faisait un tir de barrage, l’ennemi accueillait par un feu de mousqueterie assez violent la 1°vague qui, malgré des pertes sérieuses, ne fut pas arrêtée dans son élan. Cinq minutes pares la 1°vague, la dernière (4°) sortait pour assurer la liaison à droite avec la 55°DI A ce moment nos éléments les plus avancés avaient dépassé D’ et abordé le ravin : mais d’une part la 55°DI n’ayant pas progressé à droite, d’autre part à gauche les éléments du 3° Bton ayant été arrêtes à C’, les éléments de tête du 4° Bton qui allaient atteindre les tranchées de Cologne furent soumis à un feu extrêmement violent et précis de mitrailleuses placées à la corne SO du bois des Ecouloirs et aux abords du point 0. Ces éléments durent alors se jeter dans le boyau de l’Ersatz en partie comblé où ils continuèrent à progresser en rampant. Ils subirent des pertes extrêmement sérieuses, surtout en tués. En présence d’une telle situation, le capitaine Humbert, commandant ces éléments, prit le parti des les faire replier sur D’ et à l’entrée du boyau de l’Ersatz.
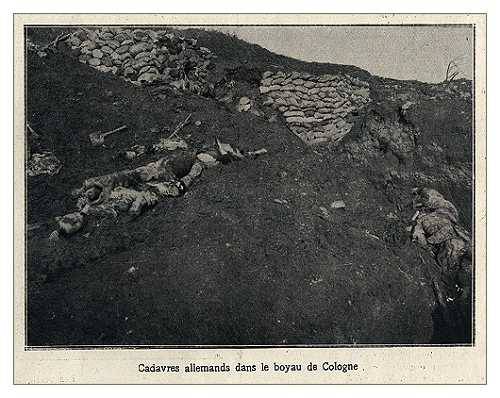
En même temps, le chef de Bton avait
fait garnir la tranchée de départ par 1 Cie de renfort du 2° Bton ;
6 mitrailleuses étaient de me installées dans la partie du boyau D la plus
rapprochée de la tranchée de départ pour contrebattre les éléments ennemis
restés dans la tranchée de la route et dans la portion de D’ située à
l’intersection de la route de Béthune et du chemin Neuville Souchez.
Le Bton s’organisera sur cette position où il suit durant la soirée
du 25.
A 17 heures, l’ordre arrivait au chef de Bton de laisser le Bton
dans la tranchée conquise qui devait servir de parallèle de départ à une
attaque du 2° Bton sur les mêmes objectifs. L’attaque fur remise
à 18 heure, puis n’eut pas lieu. Vers 20 heures la garnison de 1°ligne étant
trop nombreuse, ordre était donné au chef du 4° Bton de céder la
place aux éléments du 2° Bton et de rassembler ses unités dans
les abris W3 afin de les reconstituer.
Le 26, à 3 heures, le Chef de Bton reçoit l’ordre de se porter au
point G pour passer en réserve de Division ; au cours de cette journée,
les éléments restants du Bton sont reconstitués en 1 Cie
et 1 peloton de manœuvre. A 17 heures l’ordre arrive au chef de Bton
d’aller occuper les abris de P Magne en remplacement d’un Bton de
chasseurs appelé sur la ligne de feu.
Le 27 à 12 heures 30’, le 4° Bton
passe sous les ordres du Lt Colonel Henneton, pour faire partie d’un nouveau
groupement d’unités et va occuper la P Varoquier pour soutenir une attaque
des groupements Aubert et Laignelot sur la croupe 119. A 16h30, le Bton
reçoit l’ordre de regagner ses emplacements du début de la journée.
Le 28, à 8 heures, le Bton est remis à la disposition du colonel
Aubert, commandant la 88° brigade, puis à 12 heures passait à la disposition
du Colonel Laignelot Commandant le groupe chasseurs et recevait l’ordre de se
porter à la P Varoquier entre le B du cabaret rouge et la route de Béthune.
Le 29, à 14 heures, le Bton recevait l’ordre d’aller se placer
dans la P de Carency, à cheval sur le B du cabaret rouge, position qu’il
conservera jusqu’au moment où il quitta le terrain, le 1° octobre à 18
heures, pour gagner le cantonnement de Frevillers.
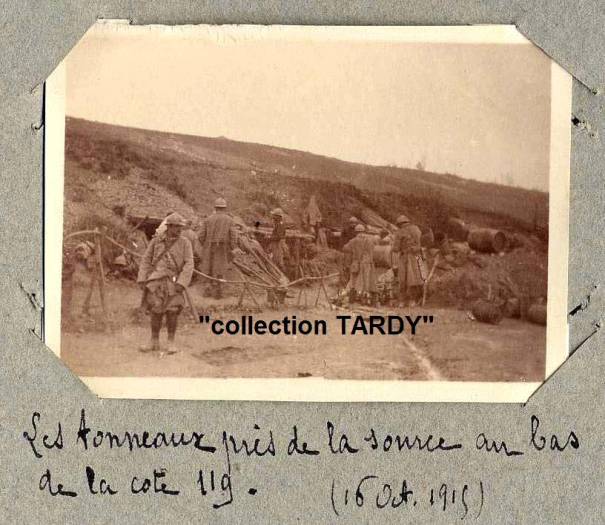
La 5° Cie en exécution de l’ordre
d’attaque précité, participe toute entière avec le 4° Bton à
l’assaut de 12h25. Dès 13h30, après nouvelles venues du front de la
bataille, la 7°Cie reçoit l’ordre de se porter sur DD’ ;
vers 17h elle envoie sur l’arrière quelques prisonniers allemands dont 1
officier.
A 16h40, le chef de Bton reçoit du chef de corps l’ordre d’engager ses Cies
dans une nouvelle attaque générale fixée à 17 heures. Ci joint copie de
l’ordre d’attaque donné par le chef de corps.
« La 88° brigade a pour mission de reprendre aujourd’hui à 17heures
l’attaque des objectifs désignés dans l’ordre d’attaque précédent ;
elle sera appuyée à droite par un mouvement simultané de la 55°DI.
L’attaque sera menée : à droite par 2 Cies du 2° Bton
et 1 Cie du 1° Bton 97° sous les ordres du Commandant
Serain ; à gauche, par 3cies du 1° Bton du 97° sous les
ordres du commandant Bourgau ; Le chef de corps disposera en outre de 2 Cies
du Bton Charles (129°RI)
Zones d’action : 1°) : attaque de droite, de l’Ersatz exclus au
boyau des Uhlans exclus ; 2°) attaque de gauche, du boyau des Ulhans
inclus à la droite du 159°
Les éléments des 3° et 4° Btons 97 constitueront la garnison des
tranchées de départ.
Pour l’exécution de l’attaque, mêmes dispositions que celles prévues dans
l’ordre précédent.
PG 25-9-15 = 16h25
Signé : de Combarieu »
Au reçu de cet ordre, le chef de Bton porte ses unités sur la 1°ligne (6° et 8° Cies et 3° Cie du 1° Bton) et s’installe de sa personne à la spe S5 à 16h55. L’inclémence du temps et l’état déplorable des boyaux gênent singulièrement le mouvement et le placement des unités ; d’autre part on constate qu’à notre droite la liaison est mal établie avec la 55° DI qui doit participer à l’action. De ce fait, l’opération se trouve obligatoirement suspendue et les unités se bornent à occuper dans la mesure du possible, la tranchée de départ et sa parallèle, tandis que la liaison est cherchée et établie sommairement avec la 55° DI.A 20h40, les éléments de la 7° Cie qui se trouvent toujours dans D sont relevés par 3 sections de la 8°Cie et retournent à la P Varoquier. Aucun incident notable dans la nuit.
Dans la matinée l’ordre est donné au chef de Bton
d’appuyer une attaque que la 70°DI à notre gauche, la 55°DI à notre
droite doivent mener sur leurs objectifs respectifs de la veille ; mais le
mouvement de cette dernière, fixé d’abord à 9heures, puis à 11 heures,
enfin à 11h30, ne se prononçant pas, le 2° Bton ne peut agir.
A 15 heures , le chef de corps communique au chf de Bton qu’à
notre gauche le 159°RI , repoussé de B’, va tenter de le reprendre par
surprise et que le 1° Bton tentera lui aussi, un coup de main sur
C’ ; Le chef du 2° Bton prescrit alors au commandant de la 8°
Cie de progresser par la gauche jusqu’en D’ en se liant au
mouvement. L’opération est esquissée, mais l’avance est impossible
(bombardement intense, pertes assez sérieuses).
Vers 18 heures des allemands en nombre se présentent devant nos tranchées pour
se rendre, d’un interrogatoire rapide de certains d’entre eux, il résulte
que D’ ne serait pas occupé ; aussi dès 18h55, l’ordre est il donné
aux 8° et 3° Cies de se porter en avant, en liaison avec le 246°RI.
La 6° passe de la P. Savourey à la tranchée de départ, la P Savourey est
occupée par 1cie du 61 Bton de Chasseurs, mise à la disposition du
chef du 2° Bton.
Le mouvement, commencé de suite, réussit, la 8° Cie se fixe en
avant de D’ et creuse une tranchée à 40 m environ en avant de cette ligne.
La situation est alors la suivante : Le 2° Bton se relie par sa
gauche, au boyau des Uhlans, au 1° Bton 97° par sa droite (un peu
en retrait), au boyau de l’Ersatz à la 55°DI. Le génie creuse un boyau
d’accès vers D’ et la nouvelle tranchée.
A 22 heures, nouvelle progression, quoique légère, de la 8° Cie
qui s’accroche sur le prolongement de C‘’’ vers S, restant en liaison
par la gauche au 1° Bton qui a , lui aussi, un peu progressé, par
la droite avec la 55°DI.
A 6 heures, avis est donné par le chef de corps de
la reprise de l’attaque à 7 Heures ; le chef de Bton prend
toutes dispositions utiles concernant le placement initial de ses unités, sa
liaison avec la 55°DI et s’installe de sa personne en D’ avec un poste téléphonique.
Le bombardement est extrêmement violent et l’attaque, qui n’a pas lieu,
doit être reprise à 14h ; dès 13h20, ordre est donné par le chef du 2°
Bton aux 3° et 8° Cies de progresser sur D’’ en
liaison avec la 55°DI qui fait savoir qu’elle a pu pousser un petit poste
dans le boyau de l’Ersatz. Bientôt à 15h55, la 8° Cie en liaison
à gauche avec le 1° Bton, occupe l boyau du Landsturn ;
certains éléments arrivent même jusqu’aux pentes 0 de 119, sur un talus à
hauteur du boyau nouveau où ils sont arrêtés par des feux de mitrailleuses. A
18 heures, la situation est assise : 8° Cie en grande partie
dans le Landsturn, 6° et 3° Cies dans D’’, 7° dans D’.
La nuit se passe sans incident ni pertes graves.
A 9h50, sur un ordre du chef de corps, la 7° Cie va de D’ s’établir en avant de D’’ sur les pentes 0 de 11ç, au 3°talus, la gauche au boyau de Cobourg, la droite à cheval sur le boyau nouveau. Le chef de Bton s’installe de sa personne en D’’. L’attaque générale se déclenche à 13 heures sur la crête pour les éléments de droite, à 13h20 pour ceux de gauche. A 14h40, le chef du 2° Bton reçoit l’avis que la progression est arrêtée ; aussi prend il l’initiative d’envoyer d’urgence la 7° Cie en renfort au Commandant du groupe chasseurs opérant à gauche. Dès qu’un nouveau Bton de chasseurs (le 57°) arrive lui même en renfort des 2 qui ont participé à l’attaque (60 et 61°), le chef du 2° Bton reprend la 7°Cie.
La situation est inchangée ; violents bombardement par intervalles, A 13h25, le chef de corps appelle à son PC le chef du 2° Bton pour lui donner ses instructions concernant un changement de secteur : le Bton glissant vers la droite, se portera dans la zone de la 55°DI (S du bois des Ecouloirs) ; la 3° Cie sera rendue au 1° Bton et le chef du 2° Bton rappellera à lui la 5° qui a jusque là suivi le sort des unités du 4° Bton. Le 2° Bton est ainsi reconstitué avec ses unités propres. A 19h la mise en place des unités dans le nouveau secteur est achevée, le Commandant du 1° Bton (Commandant Bourgau), donnant le commandement de son Bton au capitaine Bodart, prend le commandement de l’ensemble des troupes de garde.

f) 30 septembre
Un bombardement violent de l’artillerie ennemie est des renseignements fournis par l’aviation ayant donné lieu à craindre à un contre attaque, ordre est donné à la 6° Cie de se porter à la disposition du commandant du 1° Bton en 1°ligne.
e) 1 octobre
A 18h, le 2° Bton va relever en 1°ligne
le 1° Bton ; à 19h20, ce mouvement de relève est terminé, la
nuit est occupée à déterminer la situation du front des différentes unités
de 1°ligne ; le dispositif est le suivant :
6° Cie dans la tranchée de la Landwerke jusqu’à F’’’
La 7° et la 8° Cies dans la tranchée des Walkyries.
La 5° Cie en deuxième ligne.
Les pionniers du Régiment travaillent durant la nuit à un boyau d’accès à
la première ligne.
A 3 heures, le chef du 2° Bton reçoit
l’ordre du commandant des troupes de garde d’enlever en face de F’’’
un petit redan triangulaire de la ligne allemande, dont la pointe s’oriente
vers F’’’ et dont la base est constituée par une partie du chemin creux n°6.
Le commandant de la 8° Cie est chargé de l’exécution de l’opération.
A 6h30, celui ci signale qu’il n’a pu aboutir, la progression des éléments
d’attaque ayant été éventée de loin du fait du choix d’une heure trop
tardive . A 8h le chef de Bton de F’’’ et, de concert avec un
officier de la 6° Cie, prépare le plan d’un coup de main pour la
nuit.
La journée se passe sans autre incident qu’un très violent bombardement
entre 15h30 et 17h. A 19h l’opération projetée le matin est tentée et réussit.
Elle aboutit à l’enlèvement d’un petit poste, à l’occupation et ç
l’organisation d’un boyau de 60m environ mettant nos lignes en contact très
proche avec les lignes adverses.
La relève, a 20h30 arrêt les progrès de l’opération . le 2° Bton
du 97° cède alors la place à 1 Bton du 159RI et gagne le
cantonnement de Frevillers où il arrive le 3 octobre à 5h
4° Historique du 1° Bton du 97° primitivement réserve de division
Le 1° Bton, de garde dans le Ss secteur
du Cabaret Rouge, est relevé dans la nuit du 24 au 25 et prend possession de
son emplacement de combat : La 1° Cie en W2.
La 2° dans le P de Carency
Les 3° et 4° Cies au point G
Le 25 à 3 heures, ce mouvement est terminé. A partie de 11h30, le Bton
est mis à la disposition du Colonel Commandant la 88° Brigade
Celui ci envoie à 16h25 l’ordre à son chef de porter ses unités à hauteur
de la P. Savourey à la disposition du colonel comandant le 97°RI ; ce
mouvement est en voie d’exécution au moment où le commandant du 1° Bton
reçoit ordre d’attaque pour 17 heures. Les Cies n’ayant pas matériellement
pas le temps de se placer dans les parallèles de départ, l’attaque n’a pas
lieu et se trouve reportée à 20 heures.
A l’heure fixée, la 1° Cie débouche de la parallèle de départ,
mais est de suite arrêté par un violent tir de barrage
Le 1° Bton reçoit du chef de corps
l’ordre de suivre le mouvement du 159°RI qui doit attaquer l’îlot S de
Souchez à 3h ; ce mouvement n’a pas lieu. A 12h15 il reçoit l’ordre
de le tenir en liaison étroite avec le 159°RI, d’être prêt à intervenir
en cas de retraite de l’ennemi, de couvrir dans tous les cas le flanc droit du
159°RI.
A 16h30 arrive un ordre d’attaque du chef de corps pour 18h : au départ
de notre 1°vague, les Allemands se rendent, au nombre de 150 environ.
A 18h15 le Colonel Commandant le 97 donne qu chef du 1° Bton
l’ordre d’occuper la tranchée C’ et de marcher de l’avant dans la
direction de 119. Aussitôt, le Bton se porte en avant (avec 3 de ses
unités propres et la 1° Cie de chasseurs).
A 20h, après progression, la situation est la suivante : 4° Cie
dans C’’ et C ‘’’ (avec une section dans D’’) Cie
de chasseurs dans le boyau Uhlans et B’’ Sud ; 1° et 2° Cies
dans B’’
Dès 5h30, le 10 Bton se lie à un mouvement du 159°, qui marche la gauche en tête, la progression toutefois est vite arrêtée par un violent bombardement. A 14h, le Bton marche sur la tranchée de Lemberg, occupe d’abord la tranchée de Landsturn ; mais à partir de là, la progression est extrêmement dangereuse, des mitrailleuses ennemies placées au S enfilant le ravin des Ecouloirs. A 16H, le dispositif est le suivant : 1° Cie derrière le talus à l’ouest du chemin creux, ayant à sa droite 2 autres Cies du même Bton ; l’autre Cie (bientôt renforcée d’une nouvelle Cie de chasseurs) est envoyée pour passer par l’ouest vers le boyau de Cobourg. A 20h, ces deux Cies occupent l’ouest du boyau amorcé, en liaison à gauche avec le 60° chasseurs.
Le Bton occupe la tranchée de Landsturn, en liaison à gauche avec le 269° RI, à droite avec le 2° Bton du 97°
Le Bton va occuper la tranchée des Walkyries 3 Cies en ligne, une en renfort, la liaison est assurée à gauche avec le 57° chasseurs, à droite avec le 289°RI
Situation inchangée.
La 77° DI a pour mission d’intervenir si la 70°Division
à sa gauche peut s’emparer de la tranchée de Brême ; le 1° Bton
se tient prêt à partir à l’attaque de la tranchée de Lemberg par vagues
successives ; cette attaque n’a pas lieu, la 70 Division n’ayant pu
prendre la tranchée de Brême.
A 19h, le 1° Bton est relevé de la 1°ligne par le 2° Bton
et vient se placer en 2°ligne au bois des Ecouloirs. Tout se passe alors pour
lui sans incident jusqu’à sa relève le 2 octobre au soir, par le 159° RI Le
1° Bton gagne lors le cantonnement de Frevillers où il arrive le 3
à 5h30.
Nota :
En même temps que les 1° et 2° Btons, sont relevés aussi dans
la nuit du 2 au 3 par le 159°RI, le personnel téléphoniste, le groupe des
pionniers de corps. Le personnel du service d santé. Le 3 octobre dès 7h, le Régiment
est au complet à Frevillers.
Malgré une préparation d’artillerie expressément
violente, par suite de la configuration spéciale du terrain de la lutte, les
troupes d’assaut furent, dès leur sortie des tranchées, soumises non
seulement au tri de barrage prévu, mais encore à un feu de mousqueterie et de
mitrailleuses très violent, dont le résultat fut de ne permettre qu’une
avance insignifiante au Bton de droite et d’arrêter toute
progression du Bton de gauche.
L’objectif assigné, la crête 119, était séparé de nos parallèles de départ
par un ravin profond et marécageux, Les Ecouloirs, dont les deux débouchés
(Souchez au N – Bois des Ecouloirs et tête du ravin au S) étaient fortement
tenues par des mitrailleuses. Aussi, dès qu ‘elles se présentèrent sur
les pentes descendantes (O) du ravin, les Cies d’attaque furent
prises à droite et à gauche par le feu des ces mitrailleuses, subirent des
pertes et ne purent avancer. La marche en avant ne fut réellement reprise que
lorsque les troupes voisines occupèrent successivement les abords de Souchez et
la tête du ravin des Ecouloirs. La progression sur les pentes de 119 pendant
les journées des 27-28-29 septembre se fit lentement, mais en concordance avec
les unités voisines, et fut de ce fait autrement plus facile et moins meurtrière
que la traversée du ravin.
on peut, à la suite des combats du 25/9 au 2/10 faire différentes remarques
dont ci après les principales :
1 : Le bombardement intense de notre artillerie a bouleversé les tranchées allemandes qui se trouvaient en face de nous, mais laissa à peu près intact les abris ennemis installés dans la tranchée de Cologne ; aussi fut il possible aux défenseurs de garnir à nouveau partiellement les tranchées et d’arrêter notre marche par son feu.
2 : Dans un assaut tel que celui du 25/9, un des facteurs du succès est le synchronisme le plus complet dans le départ des troupes y prenant part. or, il n’en fut pas ainsi le 25/9 : l’unité placée à droite du 97°RI avait une heure retardant d’au moins 20 minutes sur l’heure officielle du 97°. L’ennemi put donc concentrer son feu sur les troupes qui se montrèrent les premières et arrêter leur mouvement.
3 : Quand au cours des opérations une attaque doit être à nouveau montée, le temps nécessaire à l’organiser est forcement très long et celui qui l’ordonne ne peut compter sur une exécution immédiate ; il faut souvent des heures entières à un Bton qui doit circuler à travers un terrain ravagé, des boyaux bouleversés et encombrés de cadavres et de blessés, pour aller se placer face à son objectif.
4 : On peut se demander si un tir d’efficacité de l’artillerie, prolongé et violent, précédent immédiatement l’attaque (comme le 9 mai) n’aurait pas obtenu un résultat meilleur ; l’assaillant aurait pu profiter de la surprise et de l’aboutissement de l’ennemi pour arriver d’un bond au pied de la pente 119.
Pertes subies par le corps durant les opérations du 25/9 au 2/10 1915
|
|
Tués |
Blesses |
Disparus |
|
Officiers |
5 |
13 |
1 |
|
Troupes |
135 |
383 |
290 |
Le 5 octobre Le Lieutenant Colonel de Combarieu Commandant le 97°RI
|
de
la Revue 'L'Illustration'
no. 3788 de 9 octobre 1915
Prise
de Souchez
La
Configuration Générale du Terrain
Quand on suit
la route nationale d'Arras à Béthune, la première localité que l'on
rencontre est la Targette, déjà célèbre par les combats qui s'y livrèrent
au mois de mai; puis la route file droit vers le Nord et descend, entre
deux rangs de peupliers clairsemés, vers un vallon où se cache un
village parmi de hautes futaies. Avant d'arriver aux maisons, la route
fait un coude à droite, à la hauteur d'un bâtiment isolé entouré
d'un jardin. C'est le « Cabaret Rouge »; puis, le coude franchi, on
laisse à gauche le cimetière; 100 mètres plus loin, on atteint la
première maison Sud de Souchez.
Le village est dans un fond. A droite monte une pente douce; on y voit des champs coupés de quelques haies, des remblais qui forment comme de petites terrasses. Sur cette crête se profilent à gauche quelques boqueteaux: c'est la pointe Sud du bois de Givenchy. Puis la ligne de faîte s'élève, se poursuit, piquetée de quelques rares arbres jusqu'à la masse sombre du bois de la Folie. Cette ligne de faîte s'élève ainsi de la cote 119, à l'Est de Souchez, jusqu'à la cote 140, au Sud. Derrière cette crête, c'est la plaine qui descend vers Douai.
A gauche de Souchez, deux vallons qui débouchent tous deux sur Souchez: le vallon du Carency et le vallon de la Saint-Nazaire, où coulent deux ruisseaux qui vont former la Souchez, qui passe à Lens. Des hauteurs dominent ces deux vallons: au Nord Notre-Dame-de-Lorette, au centre l'Eperon du Mou-lin-Topart qui descend sur Ablain-Saint-Nazaire au Nord, et Carency au Sud. Une voie unique, la ligne du chemin de fer économique du Nord, de Frevent à Lens, suit le vallon du Carency, longe le bois du même nom et vient s'arrêter à la station d'Ablain-Souchez, au coin Ouest du parc du château de Carleul; de là, elle continue sur Souchez, Givenchy, Liévin et enfin Lens. Telle est la configuration générale du terrain sur lequel se livrent, depuis le mois de mai, d'incessants combats, que vient de couronner la prise de Souchez et l'assaut de nos troupes vers les hauteurs 119 et 140. l'Organisation Défensive Allemande Quand, en mai, les officiers et soldats allemands faits prisonniers à Carency avouaient avoir reçu un ordre impérial de tenir jusqu'au dernier, ce qui n'empêcha pas plus d'un millier d'entre eux, y compris un colonel et le commandant d'un bataillon de chasseurs, de se rendre, ils confirmaient les intentions, d'ailleurs évidentes, du commandement allemand. Il fallait barrer aux Français la route de la plaine de Douai, les tenir en arrière des derniers contreforts du plateau d'Artois. En mai, il s'agissait d'empêcher les Français de prendre pied sur les sommets de Notre-Dame-de-Lorette et du Moulin-Topart. Des milliers et des milliers d'Allemands se sont faits massacrer dans ce but. Nous nous sommes pourtant rendus maîtres des hauteurs que les Allemands jugeaient d'une importance capitale et nous les avons délogés de Carency et d'Ablain-Saint-Nazaire. Il restait une étape à franchir, celle du vallon de Souchez, pour atteindre la dernière crête qui domine tout le pays à l'Est et après laquelle le terrain est plat. Cela a été l'œuvre de ces derniers jours. Souchez et son bastion avancé, le château de Carleul, étaient organisés de façon formidable. En faisant des travaux de dérivation des eaux du ruisseau de Carency, les Allemands avaient transformé au Sud-Ouest le terrain marécageux de ce fond de vallée en un marais pour ainsi dire infranchissable.
D'autre part, les batteries allemandes installées à Angres prenaient, au Nord, le vallon en enfilade; derrière la crête de 119 à 140, crête garnie de tranchées reliées par un réseau de boyaux avec les lignes creusées sur le versant Ouest, face à Carency, de nombreuses batteries contre-battaient les nôtres dans la région,Notre- Dame-de-Lorette, Ablain-Saint-Nazaire et Carency; enfin, au Nord-Ouest de Souchez, les tranchées allemandes s'accrochaient encore sur la pente de Notre- Dame-de-Lorette. On sait avec quelle obstination les Allemands avaient cherché depuis des mois à enrayer la plus petite avance française dans la direction de Souchez. Le Cabaret Rouge a plusieurs fois changé de mains et le cimetière le Souchez a vu plus de morts s'effondrer sur ses tombes bouleversées que ce modeste cimetière campagnard n'en abritait dans leur dernier sommeil. l'Attaque du 25 Septembre L'attaque du 25 septembre, sur Souchez, devait vaincre ces obstacles accumulés. La préparation d'artillerie, qui dura cinq jours, fut réglée avec tant de soin que des déserteurs allemands, avant même qu'elle fût terminée, commencèrent à se rendre dans nos lignes, déclarant qu' « ils en avaient assez ». Quand, le 25 septembre, à midi, l'attaque d'infanterie se déclancha, nos hommes, d'un seul bond, atteignirent l'objectif qui leur avait été désigné, à savoir le château et le parc de Carleul et l'îlot Sud de Souchez. Pendant ce temps, d'autres contingents enlevaient d'assaut le cimetière de Souchez, et se portaient sur les premières pentes de la cote 119. A gauche, nos forces, descendant les premières pentes de Notre-Dame-de-Lorette, se lançaient vers le bois en Hache, dont elles atteignaient la lisière Ouest vingt minutes aprè3 le déclan- chement de l'attaque. Les Allemands tentent alors, par des rafales d'obus asphyxiants, de shrapnels, de mitrailleuses, d'arrêter cette avance. Les batteries d'Angres, de Liévin, de Gi-venchy tirent sans discontinuer. Notre attaque se ralentit sous ce déluge de fer, mais la progression continue. En cette fin de septembre, la nuit vient déjà vite. Toute la journée, une pluie fine, pénétrante, n'a cessé de tomber; les chemins sont glissants; les boyaux, dans ce fond de vallon, sont à peine praticables. Malgré l'obscurité, les difficultés du terrain, on pousse jusqu'au ruisseau de Souchez; au matin, on tient la moitié du village. L'attaque de droite, arrêtée par des feux de mitrailleuses, n'a pu se maintenir au cimetière. Le commandant décide de traverser Souchez de front pour se porter sur 119. De cette façon, on débordera le reste de Souchez à l'Est, pendant qu'au Nord le corps qui a mordu dans le bois en Hache continuera sa progression. Cette manœuvre décide de la journée; Les Allemands, menacés d'être coupés dans Souchez, abandonnent la place, et ceux qui ont repris le cimetière, sur le point d'être eux aussi tournés, regagnent par leurs boyaux la deuxième ligne sur les pentes de la cote 119. Souchez est entre nos mains. En ces deux jours, 1.378 prisonniers, dont un nombre assez important d'officiers, ont été dirigés sur l'arrière. Dans le lot, il y avait un enfant de quatorze ans et demi! Les Allemands s'attendaient à notre attaque. Leurs compagnies étaient à effectif renforcé avec un nombre assez élevé d'officiers à leur tête. Cela n'a pas empêché l'élan de nos troupes d'emporter la position qui, comme Carency, comme Ablain- Saint-Nazaire, devait, d'ordre impérial, être tenue coûte que coûte. Souchez tombée, on se trouvait au pied des hauteurs 119 et 140, dont l'assaut allait être tenté. |
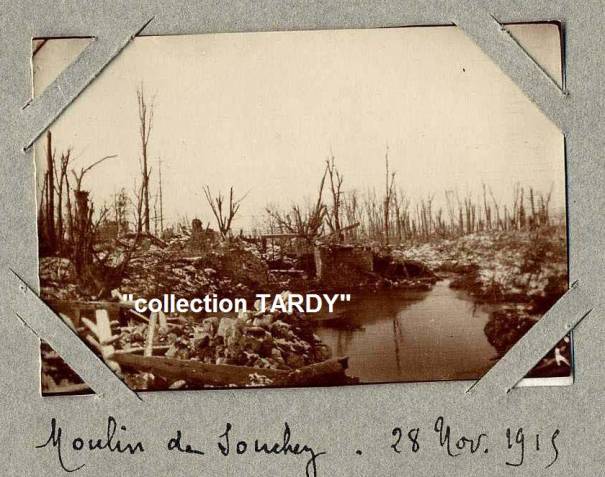

Le château de Carleul, dont il a été si souvent question, est également détruit.
|
http://www.bataille-de-verdun.fr
Sur la rive droite, du 14 au 16 mars, les
allemands attaquent le secteur de Vaux (village, étang et fort), mais
n’engagent que des faibles effectifs qui sont à chaque fois refoulés. |
|
|
14 mars 1916
Quartier Bévaux Verdun.
Embarquement du corps en auto selon les indications données la veille ; débarquement
à Regret (sortie O de Verdun) à partir de 11 heures.
Revu au débarquement note de 77°DI : « les éléments de la brigade
Aubert débarqués à Regret iront cantonner à la caserne Bévaux.
Itinéraire : route de Verdun – chemin 2 traits pressant immédiatement
au S. du mot Porte Neuve – pont de la cote 204 – Casernes.
Installation du régiment au q. Bévaux, organisation du service
|
Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Régiment d’infanterie Alpine) |
|
P79: (le 15 mars 1916) Le soir on voit des immenses lueurs rouges. Ce sont dit on des projecteurs. Le régiment doit monter le même soir aux tranchées. C’est une façon de dire car il n’y a pas de tranchées paraît il. Pourquoi ? L’avenir nous l’apprendre peut être. |
15 mars 1916
Quartier Bevaux.
Recu note de 88 Bi précisant qu’une reconnaissance pretentaine de la zone
arrière du secteur (région tunnel – fort de Tavannes) soit faite dans la
journée par les adjudants-majors _ Le colonel prescrit de suite la
reconnaissance demandée
16 mars 1916
Quartier Bévaux Verdun.
Reçu note 406B du 88BI, 12h15 sur une reconnaissance immédiate du secteur à
faire.
La même note affecte à la 88BI le s/secteur de gauche de la division. Le 97 étant
appelé à prendre le service en première ligne, le colonel repartit ainsi le
service entre les bataillons : 1°, 2° et 4° Btions (+2Cie
du 3°) en première ligne.
Revu à 17h ordre général d’opérations n°20 de la 43°DI comportant pour
la nuit du 16 au 17 relève de la 43°DI par la 77DI dans le secteur de Vaux
devant Damloup.
Cf. dossier opérations ordres de détails donnés par le colonel au sujet de
l’exécution de cette relève.
La relève s’effectue dans des circonstances particulièrement difficiles, au
pris de pertes assez sérieuses, étant donnés les violents tirs de barrage
faits sans interruption par l’artillerie ennemie durant la nuit 16/17
17 Mars 1916
PC88
Cf. carte Douaumont
Groupe des canevas de tir
Le sous secteur de la 88 brigade est divisée de la façon suivante :
S/secteur A, de la limite avec la 93°brigade (cf. carte Douaumont) jusqu’ au
village de Vaux inclus, direction générale : Nord-Sud. Front tenu par 1
Btion (Laroque).
S/secteur B, du ruisseau inclus jusqu’à 200m environ à l’ouest du saillant
I ; direction générale : Nord-Sud et Est-Ouest. Front tenu par 1 Btion
(Sérain).
S/secteur C, de la limite ouest du s/secteur A jusqu’au fond du ravin situé
à 250 m environ au NO de l’étang de Vaux . Direction Générale : Est
–0uest – Front tenu par 1 Btion (Dunoyer) et 2 compagnies du 3°
Btion (Breboin) en soutien, l’une aux environs de l’étang (talus
de la voie ferrée), l’autre sur la croupe au Sud-Ouest de l’étang
(1) pour les opérations devant Verdun, comme pour les précédentes, le journal de marche ne contient que le sommaire des opérations et renvoie à un dossier complémentaire (d.o) comprenant tous les ordres reçus et donnés, ainsi que les renseignements, recueillis au jour le jour.
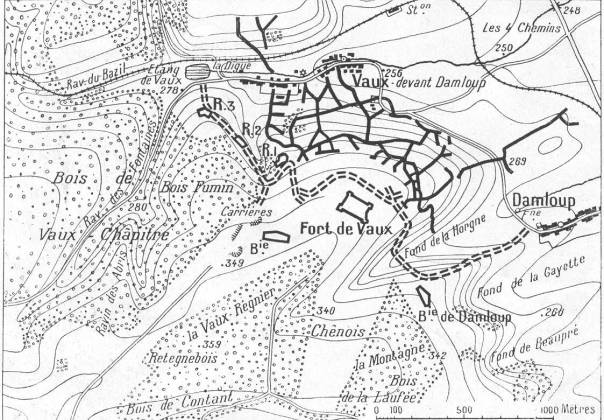
2 compagnies en réserve (du Btion Breboin) dans
les abris du ravin du bois de Vaux-Chapitre.
Dès le matin, malgré la difficulté des communications en plein jour, des
renseignements arrivent de chaque s/secteur (cd dossier des opérations,
enveloppe du 27 mars le compte rendu détaillé de chaque s/secteur).
Reçu à 15 heures note 88BI du 17 à 14h dur l’organisation du secteur de la
88 BI que doivent réaliser les troupes de garde (cd D.O.)
Reçu à la même heure ordre d’opérations n°21 de la 43 DI en date du 17/3
(cd D.O.) prescrivant l’exécution d’une attaque sur le village de Vaux dans
le but de dégager les abords du fort de Vaux
Reçu à 20h00 ordre complémentaire 970/3 de 43DI donnant des instructions
particulières sur l’attaque, en fixant la date au 19 mars à 4h30
Reçu à 22h30 ordre 410A de 88 BI, en exécution de celui de la 43 DI au sujet
de l’attaque projetée au village de Vaux (cd D.O.)

L'étang de Vaux(4 mars 1917) Frémont-lorraines

État d'un boyau conduisant au fort (L'illustration)
18 mars 1916
PC Cf carte Douaumont
Reçu entre 2 et 4 heures comptes rendus des chefs de sous
secteurs sur les évènements de la journée du 17 mars (cf. enveloppe 18mars)
Les officiers du 17°BCP sont allés pendant la nuit du 17/18 reconnaître les
emplacements des Cies d’attaque, conformément à l’ordre 88 BI n°410
A (cf. 17/3), dans les s/secteurs A et B.
Reçu à 12 heures une note de 88 BI 88 BI au sujet de la mise en place des unités
d’attaque et de l’exécution de celle ci.
Reçu à 14h45 note 409A de apportant directives au nombre des unités
d’attaque et précisions sur les objectifs à atteindre.
Reçu à 20 heures renseignement du commandant Laroque (s/secteur A) sur la préparation
de l’attaque (cf. enveloppe 18 mars) cf. même enveloppe ordre d’attaque
donné par Comdt Laroque
19 mars 1916
PC 88 Cf. carte Douaumont
A 0h20, le commandant Laroque rend compte de la mise en
place des unités d’attaque mises à sa disposition (2 Cies 17°BCP).
A 4h30, exécution de l’attaque conformément aux ordres précédents.
Premier compte rendu du s/secteur A parvient au colonel à 9 heures :
l’attaque a été arrêté par les défense ennemies non démolies par le tir
de préparation de l’artillerie
‘ cf. enveloppe 19 mars).
Reçu ordre 88 B1 de 16h au sujet de la relève du Btion Laroque dans
la nuit du 19/20 par les 2 Cies 27 BCP ayant fait l’attaque du
matin et 1 Cie Bretin, sous le commandement du Comdt
Brebion (cf. d.o).
A 22h30, le commandant Brebion fait savoir du PC A que la relève est en bonne
voie d’exécution (cf. enveloppe)
|
http://www.bataille-de-verdun.fr
Semaine du 20 au 26 mars :
Tandis que les Allemands portent leurs efforts sur le secteur ouest de la rive gauche, la rive droite connaît, pendant cette 5°semaine de bataille, une relative accalmie. Peu active, l’infanterie ne mène que de rares attaques (le 22, contre la redoute de Douaumont) qui sont toujours repoussés. L’artillerie francaise à présent répond coup pour coup à l’artillerie Allemande. |
20 Mars 1916
PC 88 cf. carte Douaumont
cf. enveloppe 20 mars comptes rendus des chefs de Btion
sur la situation tactique en 1° ligne
A 10 heures le colonel 97 donne l’ordre de relève du Btion Prat
(s/secteur B) par le 57° BCP dans la nuit du 20 au 21 cf. D.O.
La relève, commencé dans la nuit, est terminé à 8h30
Reçu à 21h note n°18 du 20/3 à 15h de 77 DI sur nécessité de faire exécuter
des feux de mitrailleuses sur l’ennemi aperçu au pied du glacis de Vaux
21 Mars 1916
PC 88 cf. carte Douaumont
cf. enveloppe
20 mars comptes rendus des chefs de sous secteurs sur la situation tactique en
première ligne.
Recu à 20h30 (cf.d.o.) ordre 418 A de 88 BI prescrivant relève dans la nuit du
22/23 du groupe Brebion par le 60°BCP dans le s/secteur A.
22 Mars 1916
Tunnel de Tavannes.
23 24 25
Le colonel du 97, remplacé au PC88 dans le commandement du
secteur par le colonel commandant la 88 Bde descend momentanément au
tunnel de Tavannes, où il passe les journées des 22, 23, 24 et 25 mars. Il met
à profil ce repos relatif pour se faire renseigner sur les effectifs du régiment
et commence le travail de propositions de récompenses
Reçu entre temps :
Le 23 à 23h note 426A de 88° BI sur mouvement de relève dans la nuit du
24 au 25 : le Btion Laroque doit monter de Verdun pour relever
dans le s/secteur le 60°BCP.
Le 23 à la même heure une note de 88° BI donnant des directives générales
pour les travaux à exécuter dans le secteur de la brigade

Tunnel de Tavannes
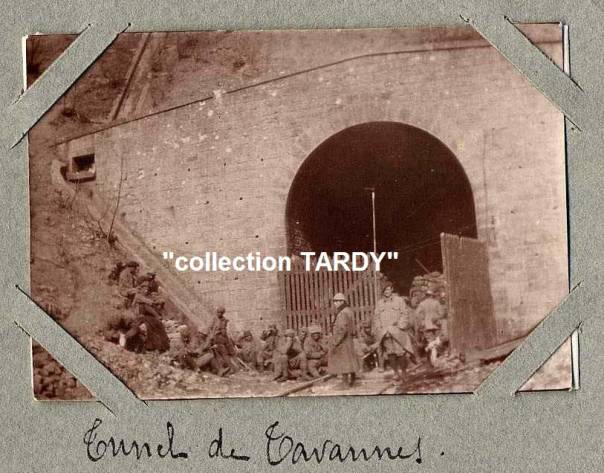
Tunnel de Tavannes
26 mars 1916
PC 88 cf. carte Douaumont
Le Colonel reprend le 25 à 22 heures le commandement du
secteur.
Cf. enveloppe 26 mars compte rendu général sur la situation tactique dans
l’ensemble du secteur.
A ce moment, la répartition des troupes de garde est la suivante
S/secteur A : 1° Btion 97 (Commandant Laroque)
S/secteur B : 57 BCP (commandant Favart)
S/secteur C : 3 Cies 17 BCP ( commandant Bourgau)
Réserve aux abris de Vaux – Chapitre : Btion Prat.
Reçu à &éh »à ordre 88BI n°436A (cf.d.o.) au sujet des mouvements
de relève d’unités à effectuer dans la nuit du 25 au 26. Pièce annexe :
tableau fixant relève des sections de mitrailleuses.
|
http://www.bataille-de-verdun.fr
Semaine du 27 mars au 2 avril :
Succédant à une période plus calme, les tout derniers jours de mars voient la reprise des offensives allemandes sur la rive droite : entre le 30 mars et le 2 avril, les tranchées francaises aux abords du fort de Douaumont, ainsi que le secteur de l’étang et du village de Vaux, sont la cible d’attaques allemandes répètes. Le 2 avril, les Allemands, après une lutte très vive, s’emparent de la partie ouest du village de vaux. Ils parviennent aussi à progresser dans le ravin de la Caillette. |
27 mars 1916
PC 88 Cf carte Douaumont
A 4 hures arrivent des sous secteurs les comtes rendus
d’exécution des mouvements de relève prescrits par note 436A, ainsi que les
comptes rendus de la situation tactique (cf. enveloppe).
A 17 heures, le colonel 97 prévient le Btion Prat (s/secteur B)
qu’il sera relevé par le Btion Dunoyer dans la nuit du 27 au 28
28 mars 1916
PC 88
Voir enveloppe 28 mars compte rendus des chefs de sous
secteur sur situation tactique
Reçu à 15h30 note 439A de 88°BI (13h) prévoyant le séjour du Btion
Laroque dans le s/secteur C jusqu’à la relève de la 88° brigade (cf d.0.)
29 mars 1916
PC 88
Voir enveloppe 29 mars compte rendus des chefs de sous
secteur sur situation tactique en première ligne.
A 16h colonel 97 prévient toutes les unités de la 88°brigade de garde
dans le secteur de leur relève dans la nuit du 30 au 31 par des éléments
de la 43° DI et fixe les détails de la relève (cf. d.o)
Reçu note 441 A du 880BI sur les cantonnements affectés au 97° après relève
(cf. d.o.)
30 mars 1916
PC. 88
Cf. enveloppe 30 mars comptes rendus des chefs de Btion
sur situation des sous secteurs
La relève des éléments de la 88°BI par ceux de la 43° s’effectue dans la
nuit du 30 mars au 31 selon les ordres donnés
Opérations du 16 au 31 Mars
Effectifs combattants engagés :
74 officiers 3340 fusils dont
157 de la CHR
214 des CMC 1 et 2
209 des 97° et 57° CMB
Pertes subies
Officiers :
Tués 2
Blesses 10
Disparus néant
Troupe :
Tués 171
Blesses 527
Disparus 78
|
Troupe |
Tués |
Blessés |
|
1° Cie : |
8 |
23 |
|
2° Cie : |
10 |
17 |
|
3° Cie : |
10 |
24 |
|
4° Cie : |
7 |
17 |
|
1° CMC : |
2 |
18 |
|
5° Cie : |
11 |
25 |
|
6° Cie : |
9 |
25 |
|
7° Cie : |
9 |
28 |
|
8° Cie : |
33 |
20 |
|
1°CMB : |
6 |
19 |
|
9° Cie : |
2 |
23 |
|
10° Cie : |
2 |
29 |
|
11° Cie : |
9 |
29 |
|
12° Cie : |
4 |
6 |
|
2° CMC : |
4 |
24 |
|
13° Cie : |
20 |
55 |
|
14° Cie : |
5 |
35 |
|
15° Cie : |
5 |
56 |
|
16° Cie : |
4 |
37 |
|
CHR : |
5 |
21 |
Carton 26N241
dossiers 7 et 8
JMO 1°CC du 10/09/17 au 23/06/19
11 juillet (1918)
Pertes au feu
12 juillet
Pertes au feu
13 juillet
Pertes au feu
14 juillet
A 23h30 attaque allemande sur tout le front du xxxxx Énorme préparation d’artillerie – Bombardement des arrières (Louvois – Tanxxxx)
Pertes au feu
15 juillet
A 3 heures envoi d’urgence de l’équipe 50/A et 110/A au xxx de Vertxx. Départ des voitures sanitaires (ordre téléphonique de l’armée).
A 4 heures attaque de l’infanterie allemande. A 1 heure message de l’armée recommandant d’évacuer tous malades et blessés. Demande de renfort automobile 2 sections sanitaires de xxxxx.
A 6 heures du matin arrivée de la SS 113 et de 15 camions T. (n°4)
Pertes au feu
Pertes au feu
17 juillet
La 45 DI regroupée occupera le secteur dit de Verzenay q.g. à Condé
Dans la nuit du 15 au 16 bombardement par avions de l’ambulance (incendie de 2 tentes Bessonneau – 1 conducteur blessé)
Le 17 bombardement du village – deux autres tentes Bessonneau sont démolis
18 juillet
L’ambulance 15/22 est transféré à xxxze l’ambulance 9/18 de Ludes à Mareuil sur Lay en renfort de l’ambulance 13/22 (camp de Grisvorge).
Pertes au feu
Une des baraques opératoires de l’ambulance de Louvois est atteinte par un obus
Pertes au feu
Pertes au feu
Pertes au feu
La 77 DI est mise sous les ordres du général commandant la 2° D.I.C.
La 131 DI est à la disposition du général commandant 1° C.A.C.
La 120 DI relève les bataillons du 23°
77 DI médecin divisionnaire médecin principal de 2° cl Gauthier q.g. à Seruxxxx
S.S.A n°16 anglaise ambulance 14/17 (médicale) ambulance 2/18 chirurgicale
Équipe B n° 123 à Sezame
Équipe A 78 Sezannes
g. B.O. /77 Charney
131 Division
Médecin divisionnaire médecin major de 1 ° classe Picqué
Ambulance 223 chirurgical laissée à la X° armée
Ambulance 1/92 à Bourgy réduite à son médecin chef g.B s/131 Bouzy
S.S.W 581 Bourgy
Pertes au feu
Blessès136 h
Gazés 6
La division xxxxelle attaque
Pertes au feu
Pertes au feu
25 juillet
Attaque allemande sur la cote 240 et Vrighy (repoussée)
Relève de la s.s.s 43 par la s.s. n°4
Pertes au feu
Départ de la 120 DI arrivée de la 168 DI
Relève de la s.s. U 593 par la s.s. 24
26 juillet
Pertes au feu
27 juillet
Pertes au feu
168 médecin divisionnaire médecin principal Vallet g.B.D 168 xxxx ambulance 2/82 (médicale) à Mareuile 7/8 (chirurgicale)
Equipe chirurgicale 116/B g.c.c. 171
S.S.A. 29 Ferme Cosson et au Cardran
28 juillet
Pertes au feu
Arrivée du médecin major Guillement détaché provisoirement à la direction du Service de Santé
29 juillet
Pertes au feu
Bombardement toxique sur le front de St EphnaiseVrigney
30 juillet
Passage à l’armée de toutes les ambulances chirurgicales des DI
2 DI.C
ambulance 3/22
C.S.R. 19
Equipe n°110/A
3 DI.C
C.S.R. 105
Equipe chirurgicale n°111/A
ambulance 4/45
C.S.R. 41
Equipe chirurgicale n°50/A et 48/B
134 DI
ambulance 223
C.S.R. 68
Equipe chirurgicale n°186/A
168 DI
ambulance 7/8
C.S.R. 171
Equipe chirurgicale n°116/A
77 DI
ambulance 2/18
C.S.R. 130
Equipe chirurgicale n°78/A et 112/B
30 juillet
Pertes au feu
31 juillet
Pertes au feu
La 168° DI passe complètement au CA
Bombardement par obus toxiques sur Silley
Très nombreuses intoxications (Yperite)
Pertes au feu
2 Août
Pertes au feu
Par ordre 1871/3 du 30 juillet de l’armée le 1°C A C
doit réaliser le plus rapidement possible l’organisation suivante
Secteurs
Sernieres 45 DI
Ecxxeil 168 DI
Montchxxx 134 DI
Leides 3 DIS
Vergency 2 DIC
La 131° DI relèvera dans le secteur Vergenay la 45° DI
qui relèvera elle même dans le secteur Scrxxxx la 2° DIC qui sera mise au
repos pendant une dizaine de jours avant de libérer la 131°DI
Le q g de la 2 DIC fonctionnera à Mareuil le 6 à 12 heures
2 B° Indochinois sont mis à la disposition de la 131 DI
3 aout
1 équipe de 14 hommes du g.B.C. xxx à St Clerey pour la désinfection
du terrain ypérite le 2 août au soir. Retour le 3 août à 18 heures
sont Dispositif des formatons sanitaires
168 DI 1 ambulance 2/82 à Mareuil sur Lay (renfort)
g D 168 Vxxlle Domxxxze
45 DI 1 ambulance 3/45 à Montchenot (renfort)
g.B. D/45 Derxxxx
3 DI 1 ambulance 9/18 Bougy g.B.D. /3 Ludes
131° DI 1 ambulance 1/92 à Bougy g.B.D. /131 Verzy
2 DIC 1 ambulance 13/22 à Mareuil g.B.D. /2
Mareuil
Le mouvement d l’ambulance 2/82 et 9/18 a lieu dans la nuit du 3 au 4 et xxxx
3/45
Par ordre de l’armée, l’ambulance 223 est dirigée sur Verty l’ambulance
3/22 sur Verty l’ambulance 4/45 sur St martin d’ablais
Mouvement le 4
L’ambulance 7/8 à Epernay (quartier marguerite) vient à l’hôpital Rolland
à Epernay
L’ambulance 15/22 dont le personnel avait été détaché à Sézanne en
renfort pour le triage – rejoindra le 5 août le centre d’Avize
Pertes au feu
Retour des 50 hommes du G.B.C prêtés à la 2°DIC avec
les pharmaciens auxiliaires Laurencien et Rivat
L’ambulance 12/22 est laissée à la disposition du 1° C Ale pour le service
du centre chirurgical de Louvois
L’A 15/22 est dirigée vers Avize par le centre A de Sézanne (message xxx la V armée du 2 août et message xxxxx 2726 du 3 août)
La 45° et 168° avant d’être rattachés au 1°CAC
L’A 3/45 quitte Montchxxx
La 2°DIC se porte à Tour s/Marne
La 77 DI passe xxx xxxx dans CA à Pierry ( O.Journal n°1328)
7 août
8 août
· Gazés 3 off 32h
9 Août
l’A 2/82 de la 168°DI se transporte à Chenot (ordre de mouvement xxx 14 CA n°4059 du 8 août)
Blessès2 off 66h
Gazés 2 off 89h
10 aout
Les xxxx des xxx du 141° AL xxx amené jusqu’à nouvel ordre par le médecin major Deloxxx (3°DIC)
Les éléments du xxxxx quitteront cantonnements à Comté vont cantonner à Fontexxxx (ordre journal n°1332)
Blessès1 off 65h
Gazés 52h
11 août
Le 7° RIC xxx une attaque par gaz suffocants qui provoque 53 intoxications dont 31 décès (21 decs dans les PSR où au GBD – xxxxx d’atteinte dont 2 décèdes mortalité totale 58° xxxx origine toxique xxxxx envoyée par batterie de projection
· B 62
· G 4 off 86
12 août
Au front est de Bethemy le 63° et le 100° RI ont subi une attaque mixte par xxx et ypérite
Les accidents du aux gaz suffocant ont été observé et 20 hommes qui ont fourni 10 décès (50%) - 6 décès ayant survenu avant l’arrivée à l’ambulance
· B 55 + 2 off
· G 66
13 août
l’ambulance 4/92 de la 131 DI se porte en renfort de l’ambulance 9/18 à Bouzy
Le Dr Maillant et l’infirmerie de route de l’A 15/22 sont envoyés en renfort à l’ambulance 12/22
Le GBC reçoit l’ordre de se tenir prêt à faire mouvement
· Blessès1 off 28h
· Gazés 59
La relève de la 131 DI dans les xxxx de Verzenay par des unités de la 2 DIC sera échelonné dans les deux nuits du 15 au 16 du 16 au 17
14 août
Les médecins major Fleury et P Baucxxxx reçoivent l’ordre de xxxxxxxx xxxxxxx à Mareuil et d’y apporté le matériel nécessaire à leur spécialité
Le GBC reçoit l’ordre de faire mouvement demain 15 heures sur Louvois
· Blessès2 off 25 h
· Gazés 2 off 52h
15 août
A compter de ce jour (&é heures) la 77 DI passé au 38 CA
· Blessès27
· Gazés 141
16 août
· Blessès42
· Gazés 44
16 août
· Blessés 51
· Gazés 1 off 31
18 août
· Blessès1 off 50
· Gazés 27
19 août
· Blessés 13
· Gazés 3
Les éléments du service de santé laissés en place dans le secteur Vezenay par la 131 DI seront relevés le 20 au soir par la 2°DIC
20 août
· Blessés 13
· Gazés néant
21 août
· Blessés 1 off 14
· Gazés 10
22 août
· Blessés 21
· Gazés 16
23 août
Attaque par ypérite le matin sur secteur Montchinot à Reims 14°RI (130 évacués)
Blessès21
Gazés 16
La 77° DI est mise à partir du 23 à la disposition du 1 CAC pour relever la 134 DI allant au repos
L’ambulance 1/92 de la 131 DI en station à Bongy est remise le 23 à la disposition de sa division qui sera embarquée en chemin de fer à partir du 23 août 3 heures
· Blessés 10
· Gazés 85
La SHC n°44 commence à fonctionner à Fontaine s/Ay
24 août
· Blessès6
· Gazés 66
25 août
· Blessés 30
· Gazés 10
26 août
· Blessès 7
· Gazés 5
27 août
· Blessés 1 off 14
· Gazés 15
A partir du 28 août 24 heures, le secteur Verzeay sera transformé en sous secteur et rattaché au secteur Lades
28 août
· Blessés 1 off 11
· Gazés 3
29 août
La SS36 est remise à la disposition de l’armée
· Blessés 11
· Gazés 3
30 août
· Blessés 8
· Gazés 10
30 août
· Blessés 14
· Gazés 3
1 septembre
· Blessés 11
· Gazés 5
2 septembre
· Blessés 16
· Gazés 1
3 septembre
· Blessés 19
· Gazés 33
4 septembre
· Blessés 18
· Gazés 22
5 septembre
L’ambulance 15/22 commence à fonctionner à Avize
· Blessés 1 off 20h
6 septembre
· Blessés 20h
· Gazés 8
7 septembre
· Blessés 13h
· Gazés 10
8 septembre
· Blessés 12h
· Gazés 7
9 septembre
· Blessés 10h
· Gazés 2
10 septembre
La SS 113 remplace à Louvois la SS4Blessès10h
· Blessés 11h
11 septembre
· Blessés 11h
12 septembre
· Blessés 18h
13 septembre
· Blessés 6h
La SS113 est xxx par l’armée
14 septembre
le médecin major Malisant quitte la 14/22 remplacé par le médecin major Hexxxx
16 septembre
La 184° Division xxxx d’appartenir au 1°CAC xxx à 0 heure.
21 septembre
L’ambulance 15/22 quitte ses emplacements d’avxxx et vient à Mareuil (ferme Grivorge) s’accrocher à l’ambulance 13/22
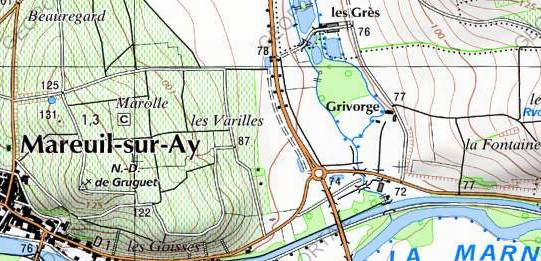

Fonctionnement à faire au 22 septembre 1918
23 septembre
La 53 DI est rattachée au 1 CAC
26 septembre
la 77 DI est retirée du front conformément aux ordre et va se regrouper au sud de la Marne
L’ambulance 13/22 reçoit l’ordre de se porter de Mareuil à xxx le 28 dans la matinée
L’ambulance 9/18 remplacera à Montchenot l’ambulance 14/17 à la date du 28
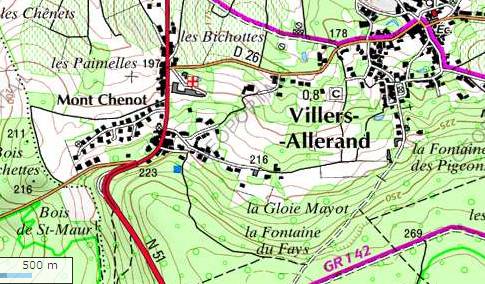
27 septembre 1918
Evacuation sanitaire à partir du 26 septembre (note n°145) du 26-9-18 de la V armée)
· Grands et moyens Blessés: Epernay Hôpital Rolland provisoirement
· Grands et petits malades petits Blessés: Vertes
· Contagieux Epernay (auban xxxx)
· Centre xxxx et de prothèse xxxx : Epernay (H. Rolland
· xxx de spécialité d’armée : Sézanne (HOE triage) provisoirement
· Centre de débordement d’armée pour les malades ne pouvant être conservé dans les CA
· Gazés : Sézanne (HOE Trxxx) provisoirement
· Eclopés , récupérables à court termes xxxxx certains : Villexxx de chat
30 septembre
Évacuation par train sanitaire xx 1/7 grxxxx (gare d’Epernay) à destination du xxxxxx
2 octobre Aujourd’hui à la suite d’un bombardement ypérite 108 hommes ont été évacués
7°RIC 94
62° BTS 5
61 BTS 8
2 BTS 1
________________________________________________________________________
Bessonneau : tente des services de santé
GBC GBD : groupe des brancardiers corps ou divisionnaire
_________________________________________________________________________
Jmo service de santé de la 77 division (26N 408/13)
Médecin Divisionnaire Legrand (médecin principal)
(1 février 1918 20 Septembre 1019
15 Août 1918
La division reçoit l’ordre d’occuper le secteur de Reims où elle relèvera la 134 DI
Le front à la forme d’un demi cercle circonserivant la ville de Reims, à une distance de 2 à 3 kilomètres
Tous les corps de troupe cantonnent dans les caves de la ville et les faubourgs
Les TC, les échelons d’artillerie, l’état major et les services vont bivouaqués en dehors de Reims
PC DI Villon Alleraz
Médecin divisionnaire et formations sanitaires installées dans la foret de la montagne de Reims à 3 km au Nord de MontChenot

Il y a à 3 km de Reims et de la route d’Epernay, à Murigny un relais de GBD et de SSA
4 Equipes de brancardiers du GBD cantonnent à Reims et ont pour mission de désinfecter les zones ypéritées.
Durant le séjour de la division à Reims, les hommes ont été soumis à de fréquents bombardements par obus toxiques (ypérite, arxxx et gaz chlorés)
En particulier, le 30 août 1918, à
2h45, le 2° bataillon du 159 RI a été l’objet d’une attaque par
projection. Le commandement estime que le nombre de projectiles lancés a été
de 150 à 200. Le départ de ces M.W. s ‘est accompagnée d’une lueur
vive comparable à celle d’un feu d’artifice ; L’explosion était
aussi fort que celle du M.W. ordinaires . grâce au service de guet, les hommes
ont pu mettre leur masque entre le moment du départ des projectiles et celui de
leur explosion.
Les pertes ont été assez faibles.
1° un homme décède au P.S. une heure après l’explosion.
2° Un deuxième, qui était, en xxxxx que gazé, atteint d’une xxx xxxx au tiers inférieur de la jambe gauche et d’une autre à la région xxxx décédé à l’ambulance de MontChenot à 11h c.à.d. 8 heures après l’explosion.
3° Un troisième , décédé à 13h, c.à.d 10h après l’explosion.
Il n’y a eu xxxx autre gazé le même jour
Les 3 hommes décèdès ne pressentaient ni brûlure de la peau, ni congestivité ; le mécanisme de la mort paraît avoir été de nature asphyxique.
17 septembre
Durant les deux jours précédents, de nombreux obus toxiques à ypérite sont tomber sur Reims
A l’hopital d’Avize, j’ai visité les malades gazés dont un était à l’agonie et deux pressentaient des accidents pulmonaires graves.
L’intoxication est survenue dans des conditions très variables :
2 malades racontent qu’ils ont été intoxiqués, dans une cave, on a alimenté le feu avec du bois imprégné d’ypérite. Le bois était coloré en jaune d’une forcex très apparente.
D’autres l’ont été en sortant de leur abri pour satisfaire ces besoins ; d’autres encore parce que ces obus à l’ypérite a éclaté inopinément très prés d’eux.
Il y a lieu de signaler que certains hommes qui ont été intoxiqués dans des caves croient que les vapeurs toxiques n’ont pu y pénétrer que par les lanterneaux car les portes étaient munies de doubles rideaux. En conséquence, il y a lieu de protéger non seulement les portes, mais aussi toutes les gaines d’aération avec des doubles rideaux.
La neutralisation des zones yperitées est effectuée dans tous les secteurs le plus complètement possible, mais elle ne sera jamais complète, en particulier dans les gravats de démolition.
Les accidents pulmonaires m’ont paru être anormalement fréquents, ce qui peut être attribué dans une certaine mesure à ce que beaucoup d’hommes dont l’état de moindre résistance du fait de leur séjour dans des caves et en raison de l’influence grippale, qui est en progression assez sensible.
Par suite, j’ai adressé les propositions suivantes :
1° Délivrer à tous les hommes des boissons chaudes en dehors des repas, deux à trois fois par jour
2° Haler dans les infirmeries tous les hommes enrhumé, ou atteints de courbature fébrile.
3° Signaler à nouveau le danger qu’il y a à utiliser comme bois de chauffage les bois imprégnés d’ypérite
4° Redoubler de soins pour fermer hermétiquement à l’aide de doubles rideaux toutes les issus des abris (portes, fenêtres et gaines d’aérations)
5° pour la neutralisation des zones yperitées, humidifier le sol ou la paroi en pulvérisant de l’eau, soit à la main, soit, de préférence avec le Vermorel, puis projeter une même couche uniforme de chlorure de chaux
28 septembre
La division est relevé par la 2°division coloniale et va au repos dans la région de Pierry
Durant le séjour à Reims il y a eu :
Yperités
127
Suffoqués 4
Blessés de guerre 200
Jean Cosmos : La Vie et rien d'autre
Par comparaison avec le temps pris par les troupes victorieuses à descendre les Champs-Élysées et dans les mêmes conditions de vitesse et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas pris moins de onze jours et onze nuits.
Annexe A :
Les vésicants.
On ne trouve dans cette classe qu’une substance ayant réellement cette caractéristique, et même si certains produits possèdent ce genre d’activité (comme les arsines vésicantes) ; seul le sulfure d’éthyle dichloré sera utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour son action vésicante puissante.
Le sulfure d’éthyle dichloré.
|
Action
physiologique
|
Vésicant,
lacrymogène et toxique
|
|
Nom de guerre |
Ypérite (France) Lost, senftgas (Allemagne) Mustard gas ou gaz moutarde (Angleterre) |
|
Formule |
Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl |
|
Epoque d’apparition |
12 juillet 1917 (Allemagne) Juin 1918 (France) |
|
Moyen de dispersion |
Obus |
Le sulfure d’éthyle dichloré fut employé la première fois par les Allemands dans la nuit du 11 au 12 avril 1917 en Belgique, sur les troupes britanniques à Ypres, d’où le nom d’Ypérite.
Généralités :
Son apparition sur le champ de bataille créa les plus vives émotions chez les Alliés ; c’est en effet le premier toxique qui permet de mettre hors de combat un homme correctement protégé par son masque. Et pourtant, son action s’exerçait surtout sur les yeux et sur les parties externes du corps. Mais à la fin de l’année 1917, en changeant le solvant dans lequel le produit est dissous et en modifiant l’obus le contenant, les Allemands obtiendront une plus fine vaporisation, entraînant une action au niveau des alvéoles pulmonaires.
Ce corps se caractérise par une persistance élevée et permet ainsi la contamination d’un terrain pendant plusieurs semaines. Cette persistance est influencée par l’accroissement de la température ambiante, augmentant la vitesse d’évaporation du liquide, et par l’humidité qui hydrolyse ce produit. Une autre de ses caractéristiques est son insidiosité ; le temps de latence est de plusieurs heures entre la contamination et l’apparition des premiers effets.
Caractéristiques :
L’ypérite est un produit vésicant, lacrymogène et toxique. Elle se caractérise aussi par sa grande persistance et sa faible volatilité. Elle n’a pratiquement aucune action par sa vapeur (point d’ébullition de 217°C) mais agit surtout sous forme de gouttelettes fixées sur des particules de poussière ou d’eau en suspension dans l’air. Elle est alors susceptible d’agir sur les voies respiratoires et sur toutes les parties du corps en contact avec ces fines particules. Elle agit également par contact direct. Les Allemands rendront son action au niveau des voies respiratoires bien plus aisée en utilisant un solvant plus volatile et en utilisant des obus dispersant bien mieux leur contenu. L’ypérite est très liposoluble et traverse donc facilement la peau. Elle détermine ainsi des lésions cutanées caractéristiques avec érythème (rougeur) puis formation de phlyctène à liquide claire. Sa concentration mortelle est voisine de 50mg/m3 pour un combattant exposé à ce produit pendant trente minutes. Sous sa forme liquide, un demi milligramme suffit à provoquer sur la peau une cloque de la taille d’une noisette et la même quantité projetée sur l’œil conduit à la cécité.
Symptômes de l’intoxication et pathogénie :
L’intoxication à l’ypérite se caractérise par une période de latence asymptomatique de plusieurs heures (4 à 8 en moyenne, mais cela peut varier de 1 heure à plusieurs jours). Les symptômes apparaissent ensuite et s’intensifient lentement pour atteindre leur maximum vers le troisième jour. Les organes les plus exposés sont les yeux, la peau, le tractus respiratoire et parfois le tractus digestif, surtout en cas d’ingestion d’aliments contaminés.
Les yeux : Ce sont les organes les plus sensibles à l’ypérite. Une brève exposition peut provoquer une kératopathie. 4 à 6 heures après l’exposition, l’individu ressent une douleur intense comme une brûlure, avec irritation des conjonctives, lacrymation (yeux qui pleurent) et gonflement des paupières. Quand l’individu peut à nouveau ouvrir les paupières, il présente une photophobie (gêne à la lumière) qui peut persister pendant des mois. La cornée est œdémateuse, trouble et parfois ulcérée. Une conjonctivite provoquée par l’ypérite reste très sensible aux irritants de toute sorte et les rechutes sont fréquentes ; des récurences d’ulcération ont été décrites jusque quinze ans après.
La peau : 4 à 24 heures après l’exposition, l’ypérité présente un érythème (rougeur), une hyper pigmentation centrée sur les follicules pileux, des sensations de brûlure et une douleur. Les régions humides du corps (creux axillaire, plis inguinaux, organes génitaux) sont les zones atteintes avec prédilection, ainsi que les régions du corps découvertes ou peu protégées. Deux à trois jours après, l’érythème s’estompe et des vésicules apparaissent et confluent en phlyctène (soulèvement de la peau rempli de liquide) remplies d’un liquide jaunâtre (il s’agit d’une épidermolyse comme celle observée dans le syndrome de Lyell). Les lésions cutanées ont une évolution bénigne, mais sont parfois le siège d’une surinfection.
Le tractus respiratoire : Si l’intoxication est limitée, seules les voies respiratoires supérieures sont touchées. Les sensations de brûlures et de douleur sont localisées au niveau de la bouche, des narines et du pharynx. On observe : rhinorhée (écoulement nasal), toux, enrouement voir aphonie (perte de la voix) et éventuellement choc. Si les voies respiratoires basses sont touchées, la fonction pulmonaire est fréquemment compromise avec tachycardie et tachypnée. Le caractère inflammatoire varie de faible à sévère puis s’intensifie en quelques jours pour donner un épitaxis (saignement du nez) et un écoulement dans les voies respiratoires supérieures, avec également formation d’une pseudomembrane dans l’arbre trachéobronchique. Entre 16 à 48 heures, on observe les premiers signes d’œdème pulmonaire qui devient hémorragique vers la 36e ou 48e heure. Au delà de la 48e heures, il est possible qu’une bronchopneumonie se développe. Elle aurait d’ailleurs une large responsabilité dans les cas mortels d’intoxication par ypérite. La convalescence, du point de vue respiratoire, est longue : l’enrouement persiste une à deux semaines et la toux pendant un mois. On observe parfois des cas d’enphysème chronique, de bronchite, d’asthme.
Le tractus gastro-intestinal : Bien que moins fréquemment affecté, nausées, vomissements et dysphagie peuvent apparaître en 24 à 48 heures. Très rarement, on aura un tableau avec hématémèse, moeléna ou diarrhée hémorragique, qui signe un pronostic sombre. L’atteinte de l’appareil digestif à souvent été constaté pendant la Première Guerre mondiale suite à la consommation d’eau ou d’aliments souillées.
Action hématologique : Dans un délai de 10 à 14 jours, on peut constater une leucopénie ou parfois même pancytopénie.
Action centrale : On observe fréquemment une asthénie (fatigue) et une tendance au sommeil qui persiste longtemps, provoquant ainsi chez l’ypérité une baisse importante de l’aptitude au travail. De nombreux cas d’apathie, de dépression ont été décrits ;
En conclusion, les formes cliniques d’une intoxication à l’ypérite sont très nombreuses : tous les symptômes peuvent être réunis ou au contraire, l’atteinte peut se limiter à une conjonctivite ou des phlyctènes. Ceci dépend de la protection du combattant mais également de la température extérieure. En été, l’homme est moins couvert et la peau est plus moite, l’ypérite passe plus facilement sous forme vapeur, facilitant l’atteinte des voies respiratoires des soldats non munis de masques.
Evolution :
La mortalité est estimée entre 2 et 10% (4,5% lors du conflit irano-irakien) mais toujours retardée. Les séquelles sont surtout oculaires (conjonctivite chronique, cécité…), cutanées (pigmentation, cicatrices, prurit…), respiratoires (bronchite asthmatiforme), psychiques (dépression, trouble de la personnalité) et génétiques (effet radiomimétique sur les tissus, en particulier le tissu hématopoïétique avec possibilité d’aplasie médullaire et favorise le processus de tératogenèse et de cancérogenèse).
L’ypérite est responsable de 80% des pertes par arme chimique durant la Première Guerre mondiale et, pour ceux qui reçurent des soins, moins de 5ù en moururent Des chiffres de l’armée américaine rapportent que sur 27.711 hospitalisés pour intoxication à l’ypérite, 599 décédèrent (2%). La moyenne de temps perdu pour ceux qui vécurent est de 42 jours. Durant la Première Guerre mondiale, moins de 3% des hospitalisés sont morts. La majorité des gazés reçurent des soins pour les atteintes oculaires et cutanées. Retenons ceci : « L’ypérite tue rarement, elle neutralise ».

Quelques lésions provoquées par les vésicants.
Annexe B :
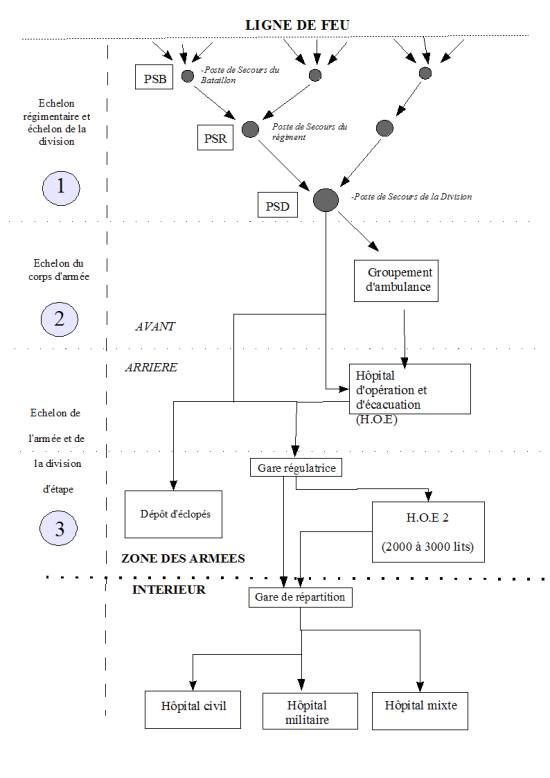
Les MUTINERIES DE 1917 - Guy Pedroncini
PUF 1967
La 77 DI , introduite sur le front de la VIe armée en vue de la bataille de l'Ailette, a eu 14 incidents (soit la deuxième en fréquence de toutes les DI pares la 5 DI (16 incidents).
La crise d'indiscipline à la 77 Dl1
Ce qui frappe, c'est sa durée - commencée dès le 31 mai, elle se pro-
longe jusqu'au 6 juin - et la variété de ses formes: nous y trouvons comme un
échantillonnage complet des types d'indiscipline, depuis les refus d'embarquer
et de monter sous le prétexte avoué d'un manque de permission jusqu'aux désertions
avec complot en passant par des mutineries au cantonnement. Mais surtout, ce qui
constitue l'élément nouveau de ces mutineries, c'est le refus, d'une gravité
exceptionnelle, de se porter en soutien d'une attaque menée par les Marocains.
Enfin les violences n'existent pas et les hommes sont demeurés fort calmes. Il
s'agit donc d'une révolte essentiellement militaire.
Dès le mois de mai, à plusieurs reprises, les hommes du 159e RI avaient
souvent dit à leurs officiers qu'ils n'iraient plus aux tranchées si l'on n'améliorait
pas le régime des permissions. De même le 60e BCP se plaignait avec force de
n'avoir pas eu de permission depuis six mois.
Aussi, lorsque la 77e DI doit remonter aux tranchées du Chemin des Dames,
n'est-il pas trop surprenant que le 31 mai 160 hommes du 60e BCP manifestent
brusquement à Blérancourdelle en réclamant des permissions. Les officiers
apaisent les manifestants et la nuit reste calme.
1. Elle est connue :
a) par les archives de la Justice Militaire. C'est la division qui a eu
le plus grand nombre
de condamnations graves (219 au total dont 42 à mort)
b) par des rapports .
- rapport du 2 juin de X... (III- Armée, GQG, 2- Bureau, Carton 2641) - rapport
du 3 juin (Vl- Armée, EM, 3- Bureau, n- 2665 13) ;
- rapport du 3 juin du général Féraud (1 -- CC, EM, n- 3756 13)
- rapport du 6 juin du général Guillemot, commandant la 77- DI
- rapport du 12 juin du général Maistre, commandant la Vi- Armée, au général
commandant le GAN (GQG, 2- Bureau, Carton 2641)
c) par des résumés -
- GQG, 2- Bureau, Cartons 2640-2654-2655 - Vl- Armée, Cartons 296-297.
C'est le ler juin que le mouvement prend une ampleur nouvelle : dans la soirée, l'effervescence recommence au 60e BCP. Plus que jamais les hommes refusent de remonter en première lignes sans permissions. Mais, à la différence de ce qui s'était passé aux 23e et 133e RI, les protestataires restent calmes,
ils font la grève des bras croisés',
et lorsqu'ils quittent leur cantonnement, à 400 environ, pour aller faire je
tour des villages voisins et soulever d'autres unités2, ils se
forment en colonne pour se déplacer. Rien des manifestations tumultueuses de la
Brigade Bulot. Mieux, le soir ils acceptent de regagner leur cantonnement sous
la direction de leurs officiers.
Bien entendu, ces incidents ne sauraient être cités comme modèle de respect
de la discipline. Mais ils se déroulent dans le calme, il y a protestation plus
que sédition. A aucun moment ne semblent avoir été évoqués ou mis en avant
les thèmes que nous avons vu se développer aux 23e et 133e RI : seule joue la
question des permissions.
Le 2 juin, la situation se détériore. Vers 10 heures du matin, 250 à 300
chasseurs quittent Blérancourdelle en laissant au cantonnement leurs fusils et
leurs effets et se dispersent dans les bois environnants3. Ils
auraient déclaré qu'ils n'ignoraient pas qu'ils seraient bien gardés,
mais qu'ils ne voulaient pas d'effusion de sang et qu'ils ne répondraient pas si on leur tirait dessus4.
Mais les autres chasseurs du 60e BCP refusent de se joindre à eux, et
acceptent dans l'après-midi d'être embarqués en (camions, et cela en présence
des mutins du matin qui persistent dans leur refus.
Or, depuis le matin, deux brigades de cavalerie, pour éviter toute extension du
mouvement, entourent et isolent Blérancourdelle. Les cavaliers ont reçu
l'ordre formel de ne par, user de leurs armes, sauf s'ils étaient attaqués, ce
qui paraît hors de question.
Devant l'obstination des mutins, le général Féraud donne l'ordre de resserrer
autour d'eux le cercle de la cavalerie et de s'en emparer
au besoin par la force5.
Alors le commandant du 60e BCP, Belleculée, qui est " un magnifique officier "6 et pour lequel ses hommes ont la plus grande estime, intervient. Il assure que la masse des mutins va se rallier et que si l'on veut arrêter les meneurs par la force, on va vers un choc grave, car ils ont des grenades. Eu égard à la personnalité du commandant, le général Féraud accepte d'abord de surseoir à l'emploi de la force, puis de faire embarquer les
mutins qui, ayant entendu l'appel à la raison de leur commandant, ont accepté
finalement de rentrer dans le devoir. Tandis, que ces événements se déroulaient
à Blérancourdelle, une timide agitation apparaissait au 159e Ri à Blérancourt'.
A la fin de mai, les plaintes contre le régime des permissions s'étaient
faites plus nombreuses2. Cependant le 159e RI a résisté à l'appel
des chasseurs du 60e BCP, ce qui est d'autant plus rnéritoire qu'il doit, le
lendemain, être embarqué pour Soupir.
Le 2 juin, pour éviter tout incident, Blérancourt a été isolé par un cordon
de cavalerie sur ordre du général Féraud. Cependant, vers 10 h 30, un petit
groupe, une trentaine d'hommes du 2e bataillon, s'est formé dans le village. Il
est dispersé facilement par le chef du bataillon, et l'embarque- ment se fait
sans difficulté.
Au cours du trajet, entre Braisne et Fismes, une nouvelle tentation
d'indiscipline assaille le 159e RI. Les hommes du 74e Ri (5e DI) leur crient
qu'ils sont
bien bêtes d'aller relever des gens qui ne veulent pas monter aux tranchées3.
Cependant le régiment reste fidèle, et, le soir, est installé à son
cantonnement, à Longueval, sans troubles sérieux.
Ce n'est que le 4 juin qu'un incident grave s'y produit : un peloton quitte son
bataillon4 au moment de monter en ligne pour assurer une relève.
Au total, le 159e RI s'est montré discipliné dans l'ensemble, et n'a connu un
incident grave, mais limité, qu'au moment même où il devait aller aux tranchées.
Par contre, l'agitation va gagner deux nouvelles unités de la 77e DI, le 97e Ri
et le 57e BCP, et reprendre alors au 60e BCP.
Dans la journée du 2 juin, le 57e BCP (et le 600 après sa soumission) a été
transporté à Dhuizel.
Dès l'installation au cantonnement achevée, environ 150 hommes du 57e BCP réclament
des permissions avant de retourner aux tranchées. Puis la manifestation prend
l'allure d'un refus formel d'obéir ; il faut, dans la nuit, procéder au désarmement
des révoltés et à leur arrestation.
A peine le calme est-il rétabli qu'au 97e RI une centaine d'hommes
abandonnent leur cantonnement et se dispersent. L'affaire tourne court
rapidement : dès le 5 juin ils se présentent spontanément au major commandant
les cantonnements de Braisnes et font leur soumission.
Par contre, au 60e BCP se produit l'acte d'indiscipline le plus grave. Une
attaque ayant été déclenchée par la division marocaine, un groupe de
chasseurs refuse de se porter en soutien. Il ne s'agit plus, dans ce cas, d'une
volonté de ne plus remonter aux tranchées, qui avait caractérisé
essentiellement les mutineries jusqu'alors. C'est un refus de participer à
un combat déjà engagé.
Il ne fait pas de doute qu'il s'agit là d'un des cas les plus graves de
mutinerie.
Mais par son caractère plus dramatique, il accentue l'impression que donnent
constamment les actes d'indiscipline à la 77e Di, d'avoir été, avant tout et
même exclusivement, d'origine militaire.
Est-ce le sentiment des chefs qui les ont connus, contenus, apaisés ?
La 77e DI était au repos depuis une dizaine de jours, ayant été retirée
le 20 mai du secteur de Coucy-le-Château. Son état moral et physique
paraissait satisfaisant. Le 30 mai, passée en revue, elle avait fait bonne
impression au général Guillemot1.
Etait-ce une apparence ? Certains officiers en jugeaient autrement
Il est hors de doute que le mécontentement est général parmi les hommes et qu'il ne date pas d'aujourd'hui2.
Sans doute n'y a-t-il pas contradiction entre les deux appréciations
les hommes de cette bonne division pouvaient être mécontents du régime des
permissions, et ils l'avaient dit en mai, sans pour autant manquer aux exigences
d'une revue où le point d'honneur de l'unité était engagé.
En effet, les combattants de la 77e DI ont tous mis en avant la question des
permissions. Depuis Verdun, ils n'ont jamais eu un long repos, alors que
d'autres Di ont eu de quelques semaines à six mois, que les troupes de l'arrière
ont leurs permissions au jour dit3.
Tant qu'ils ont pu espérer être maintenus au repos, ils n'ont pas manifesté
le fond de leurs sentiments.
Mais le ler juin, à l'annonce du renvoi de leur Dl dans un secteur actif, les
protestations ont fusé : les hommes ne veulent pas se faire tuer avant d'avoir
revu leur famille4. Cela mérite deux remarques : il n'y a pas de
refus de remonter ultérieurement d'une part, et d'autre part ce sentiment qu'il
est impossible d'aller en ligne avant d'avoir été chez soi est si fort que même
les soldats qui rentrent de permission soutiennent leurs cama- rades
protestataires. Bien entendu, cette attitude est peu conforme à la discipline ;
mais le commandement qui a restreint les permissions a abusé du courage des
hommes5. N'allait-il pas au-devant de pareilles mésaventures ?
Exiger presque l'impossible au nom de la discipline, en donnant
de surcroît l'impression que l'on ne sait pas trop ce qu'on veut, peut être
supportable quand il n'existe pas de danger, à la caserne, en temps de paix.
Cela devient difficile et dangereux après trois ans de guerre et de promesses
nombreuses, mais peu ou mal tenues1.
Après les critiques contre les permissions, les troupiers de la DI se sont
enhardis : s'appuyant sur leurs expériences antérieures, ils ont blâmé la
manière dont le Commandement supérieur agissait à l'égard des troupes:
Nous ne reprochons rien à nos officiers, à notre colonel, mais le Commandement veut encore nous lancer à l'attaque comme à Barleux et nous faire massacrer2.
Car les soldats ont remarqué que le Commandement n'écoute jamais l'avis de
nos chefs directs quand il s'agit d'attaquer3.
A ces raisons les troupiers en ajoutent une autre . les impressions qu'ils ont
ramenées de l'intérieur sont mauvaises : les discussions à la Chambre, les
embusqués trop nombreux leur paraissent choses inacceptables.
Il apparaît donc aux officiers que l'essentiel des causes du mécontente- ment
est d'origine militaire : repos insuffisant, permissions trop rares, attaques
mai préparées et sans résultats. Les actes d'indiscipline ont confirmé cette
analyse.
Il nous est possible d'apporter maintenant une confirmation indirecte, puisque
nous connaissons les soldats indisciplinés passés en Conseil de Guerre.
Au 159e RI, 1l coupables sont traduits en Conseil de Guerre pour DE avec complot
: 5 pour l'affaire de Blérancourt, 6 pour celles de Longueval et de Bourg et
Comin.
Ce sont des actes d'indiscipline moins graves. Les peines sont plus légères :
1 à 6 ans et 9 à 5 ans de travaux publics. Une seule, 10 ans de détention,
est grave. De plus, le Conseil de Guerre accorde 5 fois les circonstances atténuantes
et 6 fois le sursis4.
Au 97e RI, pour l'affaire de Vieil-Arcy du 3 juin, 8 soldats sont condamnés
pour APE . 3 à mort (2 grâces, 1 fusillé), 2 à 7 ans et 3 à 5 ans de
travaux publics5. Le Conseil de Guerre a accordé 5 fois les
circonstances atténuantes.
Au 6le BCP, pour l'affaire de Vieil-Arcy du 2 juin, Il soldats sont condamnés
pour DE (dont 8 DE avec complot). Le Conseil de Guerre accorde les circonstances
atténuantes à tous les inculpés (et 3 sursis).
1. Il semble bien que le général
Guillernot l'ait senti: il n'a pas hésité à faire preuve de clémence à l'égard
du 57- BCP qu'il a réintégré. Ce qui lui vaut un désaveu du général
Maistre qui exige que l'on arrête et que l'on juge les chasseurs du 57e BCP
comme les autres (GQG, 2- Bureau, Carton 2641).
2. Rapport Alixant.
3. Rapport Alixant.
4. Dates de naissances: 1882 à 1897. 10 origines différentes : Haute-Loire
(2), Hérault, Aveyron, Isère, Drôme, Seine-et- Oise, Ardennes, Parle,
Dordogme, Vendée. Professions : 6 cultivateurs, 2 polisseurs, 2 boulangers, 1
plombier. 3 SCA (8 non précisés).
5. Cf. Annexe 10.
Cela permet d'éviter la peine de mort, mais n'empêche pas de lourdes
sanctions : 1 de 20 ans et 2 de 15 ans de détention, 1 de 10 ans, de 8 ans, de
7 ans, de 6 ans et 4 de 5 ans de travaux publics'.
Au 60e BCP, 18 chasseurs au total2 ont été condamnés : 3 pour DE,
à Saint-Mard le 3 juin3 et 15 pour ROE à Soupir le 4 juin.
Dans la première affaire, le Conseil de Guerre a infligé à l'un des coupables
20 ans de détention et 10 ans aux deux autres.
Par contre, dans la seconde, il a prononcé 15 peines de mort (9 jugements
furent cassée4, 4 grâces accordées5 et 2 condamnés exécutés).
La plus grande diversité caractérise encore les condamnés : les deux fusillés
sont presque un symbole : l'un était originaire des Vosges, l'autre de l'Ariège6...
Quant au 57e BCP, c'est lui qui fournit le plus grand nombre de condamnés :
122. 48 le sont pour ROE, 63 pour DE avec complot et 11 pour DE. 23
condamnations à mort sont prononcées7, 22 aux travaux forcés (1 à
20 ans, 1 à 16 ans, 4 à 12 ans et 16 à 10 ans), et 62 aux travaux publics, (2
à 10 ans, 1 à 9 ans, 3 à 8 ans, 1 à 7 ans, 8 à 6 ans, 47 à 5 ans), 9 à 5
ans de prison.
Le Conseil de Guerre a accordé 82 fois les circonstances atténuantes et 10
fois le sursis. Il s'est montré impitoyable pour le refus de soutenir l'attaque
menée par les Marocains, mais il a été d'une évidente indulgence pour les
autres actes d'indiscipline.
Quant aux condamnés, ils permettent de prendre encore mieux conscience de cette
diversité fondamentale que nous trouvons à toutes les mutineries8.
1. Cf. Annexe 1 1.
2. Dont 2 caporaux.
3. Poursuivis pour DE avec complot, mais le Conseil de Guerre a estimé qu'il
n'y avait pas de complot.
4.On ignore les peines prononcées par le second Conseil de Guerre.
5.La mort était comrnuée en travaux forcés à perpétuité.
6. Cf. Annexe 12.
7.22 seront cassées, les 22 inculpés rejugés par la 43e Di qui a accordé les
circonstances atténuantes à tous, et de ce fait a écarté la peine de mort.
Mais aucune peine ne sera intérieure à 10 ans de travaux forcés. Le 23e est
gracié.
8. Un groupe de 23 militaires, jugés pour DE avec complet et ayant eu les
circonstances atténuantes, se sont vu appliquer la loi d'amnistie, car leur DE
avec complot "avait l'allure d'une inutinerie" - (Archives de la
Justice Militaire).
Naissance : 1883 à 1897 (c'est le seul cas où la classe 1917 soit représentée
de façon importante 27 cas).
Origines Paris (18), Seine (8), Seine-et-Marne et Haute-Marne (7), Saône-et-Loire,
Vosges et Loir-et-Cher (6), Meurthe-et-Moselle et Orne (5), Aube, Loiret et
Maine-et-Loire (4), Indre-et-Loire, Nièvre, Yonne et Oise (3), Creuse,
Bouches-du-Rhône, Eure-et-Loir, Gard, Pas-de-Calais (2), Hautes-Pyrénées,
Haute-Garonne, Loire, Nord, Somme, Puy-de-I)ôrne, Finistère, Charente, Indre,
Morbihan, Haute-Saône, Corrèze, Vienne, Seine-et-Oise, Seine-intérieure, Hérault,
Drôme, Alsace-Lorraine (5 sont ignorés).
Professions : cultivateurs (29), bouchers, rnécaniciens, employés de bureau
(4), cuisiniers, journaliers (3). Pratiquement toutes les autres professions
sont différentes (diamantaire, clerc de notaire, moulinier en soie, meunier,
commis de trésorerie, bûcheron, etc.).
Situation de famille: 21 mariés (1 enfant: 8; 2 enfants: 3; 3 enfants: 1). 101
célibataires. Situation judiciaire : 11 CA, 104 SCA (7 non précisées). (Cette
énorme majorité confirme 1) que les condamnée avaient été des soldats
" sans histoire "; 2) que les mutineries sont loin d'être le fait des
" mauvais soldats ".)
Ainsi, la diversité extrême des condamnés de la 77e DI montre que ses
actes collectifs d'indiscipline, d'allure nettement militaire aussi bien dans
leurs causes que dans leur expression - pas de violences, pas de manifestations
tumultueuses -, ne se distingueraient pas des autres si nous n'avions, pour les
connaître, que la personnalité de leurs auteurs.
Quel que soit le type de la mutinerie, le même trait commun se retrouve
partout. Il confirme ce mouvement général des soldats qui ne se limite ni à
un âge, ni à une région, ni à une profession donnés.
Il est malheureux que pour l’une des mutineries les plus graves, celle de la
170 DI, nous ne disposions plus que des archives de la Justice Militaire
restreintes aux condamnés à mort.

The Battlefield between 26 Februray and 12 July 1916
from www.war1418.com
Introduction: The Battle of Verdun is considered the greatest and lengthiest in world history. Never before or since has there been such a lengthy battle, involving so many men, situated on such a tiny piece of land. The battle, which lasted from 21 February 1916 until 19 December 1916 caused over an estimated 700,000 dead, wounded and missing. The battlefield was not even a square ten kilometres. From a strategic point of view there can be no justification for these atrocious losses. The battle degenerated into a matter of prestige of two nations literally for the sake of fighting......
The Battle for the Flanks -
The Right Bank of the river Meuse (8 March - 23 June)
The Battle for Fort Vaux
When the battle for Verdun stagnates in the beginning of March, the German army
Command
concludes that first the French artillery fire from the left riverbank has to be
eliminated, before a
successful march to Verdun becomes possible along the right riverbank. The
Battle for the Flanks is
about to begin. The attack on the left riverbank is executed by the VIth German
Reserve army corps. At
the left riverbank the battle starts on Monday 6 March. On the right riverbank
the battle starts on Wednesday 8 March; the target is Fort Vaux. The attack has
been postponed for two days because the Germans have great trouble bringing
their artillery into
position due to the terrible condition of the terrain. In the meantime the
French have reoccupied the
remaining forts and reinforced their lines of defence. The lines at Fort Vaux
are the strongest frontal
positions at this moment.
(Note: From German side the idea has been mentioned to deploy sectional mountain
guns. This idea
is dismissed: for the transportation of 12 pieces, 1200 men were needed and more
than 900 horses.
Such a caravan would be extremely fragile under severe circumstances.)
Wednesday - 8 March The attack at the right riverbank begins as
usual: first there is a drumfire of the
artillery where gas grenades are used, after that a mass infantry attack follows.
The Vth Reserve army
corps has to execute the attack under the command of General Von Guretzky and
the IIId army corps
under General Von Lochow. Fort Vaux appears to be for the taking but between
Hardoumont and Fort
Vaux runs a 100 metres deep gorge. At the bottom of this gorge the village of
Vaux is situated which is
transacted by a small river that ends in a large pond in the West. The attack
immediately stagnates
because of the fierce fire of the French, which comes from the higher situated
defence of Fort Vaux. Yet
the Vth reserve army corps receives the order to attack again. This nightly
German attack has an
unexpected success; the French were not expecting another attack and were taken
by surprise. The
village of Vaux is now in German hands and the troops have reached the defence
lines halfway on
the slopes of the fort [map]. The attack ends, however, in chaos on German side.
In the inky darkness
of the night the companies lose their way, officers disappear and there is no
communication
whatsoever. The German troops are forced to dig themselves in because of the
brutal fire coming from
the French lines.
Thursday - 9 March In the morning the German
64th Infantry Regiment is ordered to occupy the Bois
Fumin, situated next to the fort, because Fort Vaux had supposedly already
fallen into German hands.
Soon after, rumours are heard through the grapevine. There is even speculation
of German
infantrymen on top of the fort. Furthermore, an alleged red and yellow German
flag is seen blowing
on top of the fort. That same morning the following announcement can be heard:
'have reached Fort
Vaux with three companies'. This message is interpreted as 'have conquered Fort
Vaux'.
This message is spread to the world and General Von Guretzky is awarded the
highest German
decoration, the 'Pour le Mérite'. When it is discovered that the message is
incorrect this bestowing of
honour has to be reversed the next day.
The IIId army corps headed by General Von Lochow has to erase this painful
memory and is
immediately ordered to finally conquer Fort Vaux entirely.
But the unthinkable happens: two regimental commanders disobey this order as
they feel that: 'it is
useless to attack without artillery support of the flank'. The reserve forces of
General Von Guretzky
are then appointed to attack the fort without artillery support. This useless
and bloody attack is
withstood successfully by the French.
...
The Battle of the Flanks -
The Left Bank of the river Meuse (6 March - 31 May)
The Battle of Côte 304 and Le Mort-Homme
The attack on the left riverbank is executed by the VI German Reserve army
corps. At the same time an attack on Fort Vaux will be launched from the right
riverbank. The most important aim of attack on the left riverbank is a hill (height
295 metres) called Le Mort Homme [The Dead Man], which serves as a lookout point
for the French and is therefore valuable to the observations of the artillery.
After Le Mort-Homme is taken, the attack on the Bois Bourrus can begin, where
the French artillery is concentrated. The preparations for the attack have not
escaped the French and on the 6th of March, there are four French
divisions present in the lines of defence.
Monday - 6 March The attack starts with a heavy preliminary bombardment that is aimed at the inexperienced French 67th division, which forms the first line of defence. The Germans cross the Meuse fairly easily at the villages of Brabant and Champneuville. French artillery fire comes from the Bois Bourrus but has little effect because the grenades do not explode; they are smothered in the swampy ground. The French defence becomes discouraged and weakened and in the evening the villages Forges and Regneville are taken by the Germans. The Western part of the hill, Côte de l’Oie is in German hands as well.
Tuesday - 7 March The Germans march on to the Bois des Corbeaux and occupy this, under protection of their own artillery. The French defence is breaking down. At the end of this day, more than 3.000 French have surrendered. Le Mort-Homme seems to be in reach
Wednesday - 8 March Early in the
morning, however, the French launch a counterattack with great zeal. The Germans
have not consolidated their conquered positions and at the ending of the morning
the Bois des Corbeaux becomes French territory again. The planned attack by the
Germans on Le Mort-Homme is cancelled and on this day the Germans are forced
into a defensive position.
Thursday - 9 March A German attack on Le
Mort-Homme is launched from Bethincourt but the French have regained their line
of defence and the German attack is turned down.
Friday - 10 March The Germans are attacking again
with verve and recapture the Bois de Courbeaux at the cost of great losses. In
the following days a battle unravels that lasts four days and goes back and
forth continuously. Every attack is answered with a counterattack. Nothing and
nobody is spared. Eventually the front stabilises around the line
Bethincourt-Cumières. The losses on both sides after this period are enormously:
89.000 French are dead, wounded or missing; 82.000 Germans are wounded, dead or
missing
Tuesday - 14 March Again a
massive German attack is launched at Le Mort-Homme but the advancing main force
is taken under fire by the French with enormous power. They are firing from the
nearby Côte 304 [Hill 304], where a large French concentration of artillery is
situated. If the German attack stagnates with great losses on the hills of Le
Mort-Homme, the German army leaders decide to relocate the centre of attack to Côte
304, which from that moment on is perceived to be the key to conquering Le
Mort-Homme.
Monday - 20 March The German main attack is now launched from the West at the front line Malancourt-Avocourt. At Avocourt they move on quickly to the Bois d’Avocourt where the 29th division is located, which is destroyed completely. It is even believed that treason was committed on French side; defectors were supposed to have given away the French positions to the Germans. More than 3.000 men are made prisoners of war, among them are a brigadier general and two regimental commanders. In France this defeat is considered a national disaster
After these events all battles concentrate around the Bois
d’Avocourt en from Tuesday - 21 March onwards there is heavy
fighting over every metre of ground, which causes great losses on both sides. It
is a massacre under the worst possible weather conditions. It rains heavily;
wounded drown in the mud. Soldiers loose their boots in the sucking soil. Guns
and mortars sink into the mud up to their axes and cannot be moved. Whole German
battalions are slashed, sometimes until the last man, by camouflaged French
machine guns. The French artillery firings are just as heavy as the German ones.
Thursday 23 March At the end of the
day the battle is stopped for the time being.
At the end of March a German attack on Côte 304 is launched from the North: the
villages of Malancourt (31 March), Haucourt (5 April) and Bethincourt (8 April)
fall into German hands. Côte 304, however, remains French
Both sides are reporting cases of battle weariness: German and
French units refuse to leave the trenches, insubordination is common, troops
surrender willingly. The extent of what is humanly possible to endure appears to
be reached.

French troops detraining on their way to the Verdun front
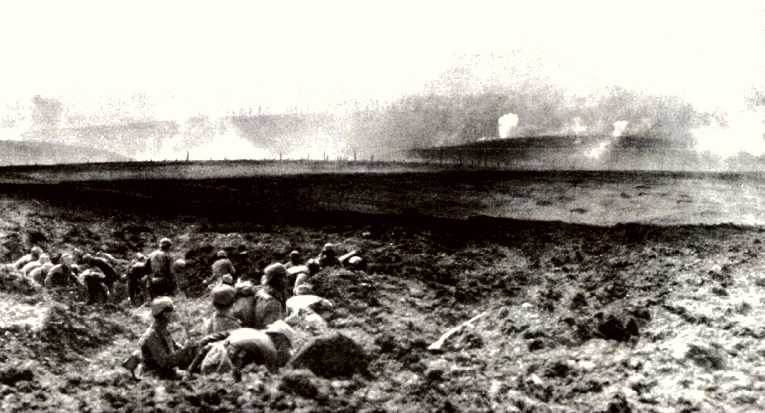
German attack on the village of Vaux
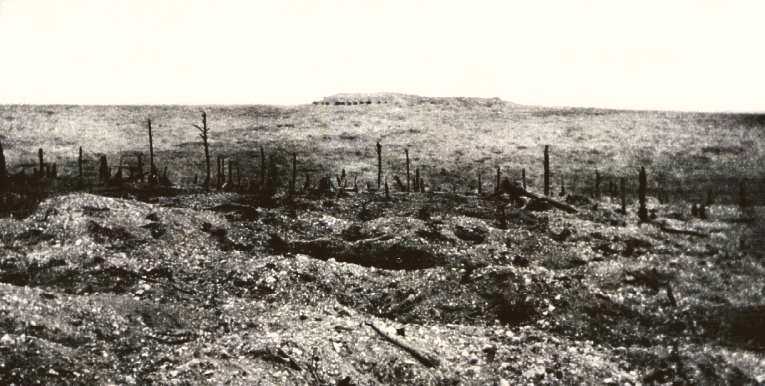
The battkefield - Fort Vaux in the background
La grande guerre chimique 14-18 Olivier Lepick PUF
avec l'aide de http://www.pourlascience.com/numeros/pls-264/livre2.htm
Le 26 avril 1915, à 17 heures, l'armée allemande déverse 150 tonnes de chlore, enfermé dans 5 830 cylindres, sur un front de six kilomètres de large, près du village de Langermarck, dans le saillant d'Ypres, au Sud de la Belgique. Un nuage verdâtre, poussé par le vent, se dirige, à la vitesse de deux à trois mètres par seconde, vers les lignes françaises ; dans la panique indescriptible qui s'ensuit, le front français est rompu sur près de deux kilomètres.

C'est ainsi que naquit la «guerre chimique» – l'expression «guerre des gaz» est moins appropriée, car de nombreuses armes chimiques ne sont pas des gaz – qui marqua la mémoire collective européenne. Spécialiste d'histoire militaire, Olivier Lepick donne un ouvrage fondamental sur ce sujet. Le sérieux de son étude n'étonne pas, puisqu'elle fut réalisée dans le cadre d'un doctorat d'histoire ; ce qui surprend très agréablement, c'est la lisibilité parfaite de l'ouvrage et le talent avec lequel l'auteur fait partager ses découvertes.
L'emploi de l'arme chimique durant la «Grande Guerre» fut la réaction à une situation stratégique que les états-majors français et allemands n'avaient pas prévue : on avait misé sur une guerre rapide, avec beaucoup de pertes, car la puissance de feu des belligérants semblait empêcher une guerre longue. Erreur : si les premiers mois ont bien été très meurtriers, ils ont fait sombrer la guerre dans une gigantesque guerre de siège, la «guerre des taupes», où une ligne continue de tranchées séparait les adversaires, de la mer du Nord à la Suisse. L'auteur montre comment, dans l'impasse, les états-majors ont recherché l'arme qui ferait revenir à une guerre de mouvement.

Dans l'angoisse des gaz de combat... |
Malgré les conventions internationales qui proscrivaient l'utilisation de «gaz asphyxiants ou délétères», tous les belligérants avaient employé, dans les premiers mois, des munitions chimiques lacrymogènes et irritantes, analogues aux munitions utilisées par la police pour le maintien de l'ordre en temps de paix ; les résultats avaient été décevants. En Allemagne, le chimiste Fritz Haber (qui avait découvert un procédé de synthèse de l'ammoniac) est l'inspirateur et l'organisateur de l'effort de guerre chimique : il propose d'utiliser le chlore, car ce gaz, puissant irritant des voies respiratoires, provoque une mort rapide quand l'inhalation est importante. L'industrie chimique allemande, alors la plus puissante au monde, peut fournir le chlore en quantité, mais le caractère limité de l'attaque du 22 juin 1915 et de celles qui suivent très vite ne rompt pas le front de manière durable. Plus tard, Haber regrettera que l'on n'ait pas effectué, comme il l'avait proposé, une attaque massive aux gaz «pour sortir de l'impasse de la guerre».
Très vite, la riposte française et britannique s'organise : identification rapide du gaz, prescription de mesures de protection (tampons respiratoires), organisation scientifique de l'effort de guerre chimique, avec la recherche de nouvelles substances toxiques, et mise au point de la fabrication industrielle des munitions correspondantes.
D'avril 1915 à juillet 1917, les gaz de combat sont de plus en plus utilisés, mais leur efficacité décroît ; les masques de protection ont progressé, et les fantassins ont généralement pris des habitudes plus rigoureuses pour leur protection. Aussi, après des tests à la fin de 1916, l'Allemagne utilise, en juillet 1917, le sulfure d'éthylène dichloré, qui sera également connu sous les noms de gaz moutarde (à cause de son odeur) et d'ypérite (c'est près d'Ypres qu'il a été utilisé en juillet 1917). Ce composé, connu depuis 1860, est un liquide huileux, peu volatil, qui attaque les yeux, la peau et les muqueuses en les rongeant et en les nécrosant ; l'«effet retard» qu'il présente ajoute à son efficacité diabolique et à son caractère insidieux.
En moins d'un mois, les services scientifiques français identifient le nouvel agent toxique et le font produire en quantités industrielles, malgré des difficultés techniques considérables et les accidents causés par la toxicité du produit. Les premiers bombardements français des lignes allemandes par l'ypérite ont lieu en juin 1918, dévastant les troupes allemandes, surprises par cette réplique qu'ils n'attendaient pas si tôt. Ni la France ni l'Allemagne ne trouveront de parade efficace contre l'ypérite avant la fin de la guerre : les combattants étaient condamnés à s'appliquer des pommades spéciales sur le visage et à porter des vêtements huilés, inconfortables et difficilement conciliables avec la mobilité nécessaire des fantassins des premières lignes.
Les historiens ont beaucoup discuté les pertes dues à la guerre chimique. Selon O. Lepick, le nombre total des victimes est compris entre 710 000 et 1 000 000, soit 2,3 à 3,2 pour cent du total des victimes militaires ; sur le front occidental, le nombre de morts parmi ces victimes serait de 17 000, soit 0,5 pour cent de l'ensemble des morts dénombrés sur ce front. Les gaz et autres toxiques semblent avoir blessé et invalidé beaucoup plus qu'ils n'ont tué : de nombreuses victimes de guerre durent suivre un traitement médical pendant le reste de leur existence.
Sur le front occidental, les gaz causèrent, entre 1915 et 1918, la mort de près de 17000 soldats dont près de 50% au cours des onze derniers mois de la guerre (en raison de l'ypérite).
Au cours de l’année 1918, la pathologie la plus commune n’était plus l'inflammation des poumons et des voies respiratoires mais plutôt les brûlures et les vésications produites par le gaz moutarde. Si les blessures provoquées par le sulfure d'ethyle dichlore étaient particulièrement douloureuses, elles n’étaient que rarement mortelles. Elles nécessitaient cependant des soins intensifs et mobilisaient donc un personnel médical important. Dans les cas les plus sérieux d'inhalation de gaz moutarde, l’irritation des poumons et des voies respiratoires pouvait dégénérer en pneumonie et provoquer la mort du patient. Ces complications représentaient environ 1 à 3% des cas de blessures par gaz moutarde.
L'apparition de l'ypérite et ses ravages obligèrent les autorités françaises a reformer l'organisation de leurs services médicaux. Des le mois d’août, chaque corps disposait de deux ou trois antennes de désinfection comprenant des postes de lavages et des douches ainsi que des personnels médicaux spécialisés (Ambulance Z).
L'auteur souligne la distorsion entre le nombre réel des victimes et l'idée qui subsista : nombreuses sont les familles qui conservent le souvenir de l'«arrière-grand-père gazé durant la Grande Guerre» alors que, pour l'auteur, il y eut une large confusion entre les ravages de la tuberculose dont ont été atteints de nombreux anciens combattants et les conséquences physiologiques de la guerre chimique.
La majorité des historiens qui se sont intéressés à la guerre chimique ont conclu à l'efficacité remarquable des gaz de combat, mais il leur manquait des sources que O. Lepick a étudiées et qui conduisent à une conclusion radicalement différente : globalement, malgré quelques réussites locales, ces armes n'ont pas procuré les succès tactiques qui en étaient attendus.
Au cours des six derniers mois du conflit, près de 20% des obus tires par l'artillerie contenaient des substances toxiques.
Impact psychologique des gaz : Certes les gaz étaient craints et les hommes n'aimaient pas y etre confrontes, mais une fois qu'ils étaient devenus familiers avec les toxiques et qu'ils savaient pouvoir compter sur leur masque, une sorte de fatalisme semblait s'imposer. Avant les gaz, avant même les obus, les pires ennemis du poilu semblaient être le froid, la soif, la boue et l'ennui.
Toutefois, seuls les gaz parvinrent à provoquer des phénomènes de paniques généralisées au cours desquelles des unités entières abandonnèrent leur poste pour se ruer en masse vers les arrières.