

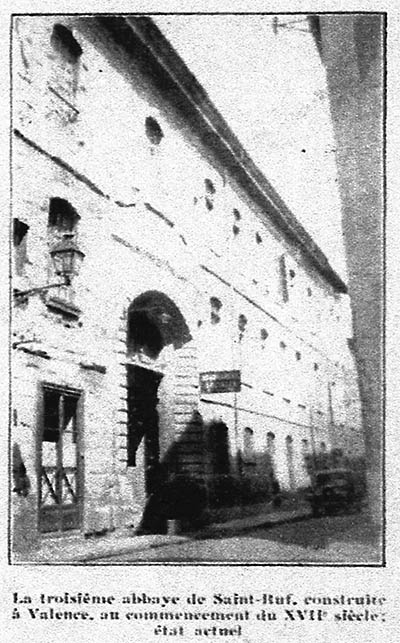
L'ordre de Saint Ruf suivant la règle de Saint Augustin fut fondé en 1039 par quatre chanoines de la cathédrale d’Avignon (Saint Ruf, 1er évêque d' Avignon). Les chanoines de Saint-Ruf desservaient les nombreuses églises qui leur étaient confiées par les évêques tout en menant une vraie vie monastique. Les chants de l'office de jour et de nuit aux intentions des fidèles et les œuvres de charité avec un peu de travail occupaient leur vie. Ils étaient vêtus d'une tunique blanche et d'un surplis dans leur monastère et lorsqu'ils sortaient, recouvraient le tout d'un manteau noir avec capuce Cet ordre a possédait jusqu’à 800 prieurés (500 eu France, 300 à l'étranger : pays méditerranée et nordique). L'ordre fut présent lors de la première croisade (1096-1099). Les chanoines accompagnèrent en Terre Sainte Raymond de St Gilles, comte de Provence, jusque dans le royaume de Tripoli où celui ci leur fit construire une église consacrée à Saint-Ruf.
Les prieurés de Lignan (Notre-Dame) et de Manduel (Saint Genest) sont concédés à Letbert abbé de Saint Ruf le 26 mai 1106 par Raymond, évêque de Nîmes (chanoine de Saint Ruf).
En conflit avec les institutions de l’église d’Avignon, Saint Ruf se transfert en 1158 à Valence (L'abbaye de Saint Ruf d'Avignon fut détruite en 1156 par les Albigeois).
Ainsi une deuxième abbaye fut construite en dehors de la ville (site insulaire de l'Épervière) grâce au pape Adrien IV (chanoine de Saint Ruf). Elle fut détruite en 1552 par les protestants (François de Beaumont, baron des Adrets). Les chanoines se réfugièrent dans les murs de la ville où ils construisirent une troisième abbaye autour de leur prieuré de Saint-James avec l'aide de Henri IV, roi de France . Le palais abbatial construit (XVIII° siecle) au nord de cet ensemble fut la résidence des préfets de la Drôme jusqu'à sa destruction par un bombardement en 1944
Le bénéfice des prieurés de Manduel fut jusqu'en 1775, perçu par les chanoines réguliers de Saint Ruf de Valence. A la sécularisation de cet ordre, le prieuré devint séculier et la cure qui jusqu'alors avait été administrée par les chanoines de Saint Ruf, devint également séculière et de collation épiscopale (évêché de Nîmes).
De 1106, date de la cession des prieurés de Manduel et de Lignan à l'ordre de Saint Ruf jusqu'à sa suppression en 1775 (à valider : supprimé par la "commission des réguliers" en 1772) , les archives départementales de la Drome (série 2H) contiennent une partie importante de la "mémoire » de notre village. On y apprend dans l’inventaire du XVIIIéme siècle concernant Manduel, que le village était entouré de fossés et de fortifications, et que le prieuré fut pillé et ruiné le 19 août 1578.
Le prieuré percevait la dîme redevance, d'un dixième du revenu dû par tout fidèle à sa paroisse De nombreux litiges survinrent entre le prieur et les habitants de Manduel à propos de la dîme. La lecture des plaintes et des procès permet d'avoir un aperçu de la vie économique de ce village au Moyen-Âge.
Bibliographie
- Abbayes et prieurés de l’ordre de Saint Ruf par A. Carrier de Belleuse. Romans 1933.
- Thèse de l'école des Chartes (1967) par Yvette Le Brigand : l'Ordre de Saint ruf en France 1039-1774
(ACPM 1994-16)
En 1169, il est rattaché à l’Ordre de St RUF de Montpellier et le restera pendant 6 siècles jusqu’à la dissolution de l’Ordre en 1775, date à laquelle il est rattaché au Séminaire de NIMES (https://escaunesetcantarelles.over-blog.com/pages/L_eglise_de_Sernhac_un_patrimoine_precieux_a_sauvegarder-3767960.html)
Manduel : population 2103 catholiques 13 protestants
Statut en 1775 un bénéfice claustral, prieuré simple & régulier du
titre de St Genest d'Arles, uni à la mense capitulaire des chanoines réguliers
de St Ruf. La paroisse était réglée par un vicaire perpétuel à
portion congrue qui appartenait à St Ruf et par un vicaire secondaire.
- La congrue du curé était de 300 lt et celle du 2° de 200lt
- Une aumône de 45lt
- honoraires de prédication du carême de 60lt
- 67-10- pour les menues dépenses d'entretien
- le leg de Charles Pascot qui rapporte 15lt
- il existait une Chapellerie de St Blaise, à titre de bénéfice, de la collation de l'évêque de Nîmes et dont les revenus reposent sur une terre labourable : 30lt
Prieures simples et réguliers :
Manduel, uni à la mense du chapitre des chanoines réguliers de Saint Ruf de Valence
- titre : Saint Genest
- Revenus : 3500
Chapelles :
- Legs pie de Charles Pascot, prêtre, fait au curé du lieu. Revenus : 20
- Saint-Blaise : Collateurs : l'évêque de Nîmes. Revenus : 100
1729 1750 Pouillés des diocèses anciens compris dans le diocèse actuel de Nîmes / par E. Goiffon 1900 (cf pdf)
Pouillés = dénombrement des bénéfices ecclésiastiques
données A : AD du gard G55 redigé en 1729
données B : 1750 "histoire de la ville de Nimes " ( Menard 1875
VI Pouillé du diocèse de Nimes p. 52)
item 28 : Prieuré(*) simple et régulier de Saint-Genest de Manduel,
uni à la mense des chanoines réguliers de Saint-Ruf de Valence. —
A.
Revenus affermés 2.800-3-3 . Charges 672-10- .
Revenu net 2.127-13-3
B. Revenu 3.500 livres.
item 66 : Vicaire ou curé à portion congrue à la collation du Chapitre régulier de Saint-Ruf de Valence. Revenu net 325 livres
item 98 : Légat fait par feu Charles Pascot, prêtre, au curé de
Manduel,
A. Revenu sur une terre labourable au terroir de Manduel, tailles
déduites, 8 livres 12 sols 5 deniers.
B. Revenu 20 livres.
item 99 : Chapelle de Saint-Blaise (**),
à Manduel, à la collation de l’Évêque de Nîmes. -
A. Revenu net 10-10-
B. Revenu 100 livres.
L'aliénation des biens nationaux dans
le Gard / (F Rouvière p.82) :
*) vendu comme Bien National le
17/11/1791 par Antoine Bancel 1 terre dite la vicairie 1000 livres
(**) vendue comme Bien National le
17/11/1791 par Antoine Bancel 7 pièces de terres 3 salmées 48 ém ... pour
12000 livres
Avec le 12° commence la période de l'apogée de l'ordre de Saint Ruf ... Les actes de donation d'églises commencent à ce multiplier à partir de 1075 et ne sont pas le fait de seigneurs laïcs, mais des évêques... Sur la rive droite du Rhône, sont réunis plusieurs églises qui appartiennent à l'ordre depuis le 11° : Maugio, Caveirac, Aimargues et Manduel... Une liste des bénéfices de l'ordre au 16° donnant pur chaque prieuré le nombre de chanoines qui doivent y résider (entre 2 et 12 selon qu'il s'agit de prieurés cures ou de prieurés conventuels) ==> donne ~ 300 chanoines
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
